littératures européennes Cognac
Extraits
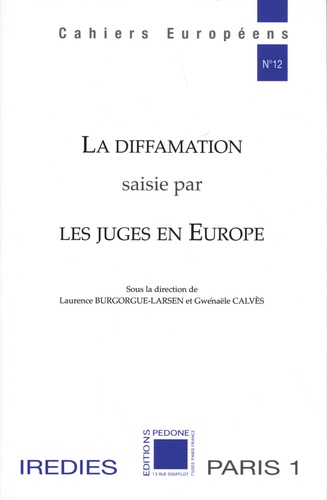
Droit
La diffamation saisie par les juges en Europe. Textes en français et anglais
11/2019
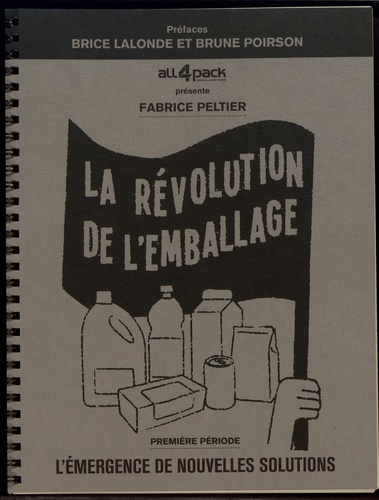
Décoration
La révolution de l'emballage. Première période, L'émergence de nouvelles solutions
11/2020

Droit
Nouvelles missions de la Défense : quel cadre juridique ? Enjeux et perspectives, Edition bilingue français-allemand
12/2021
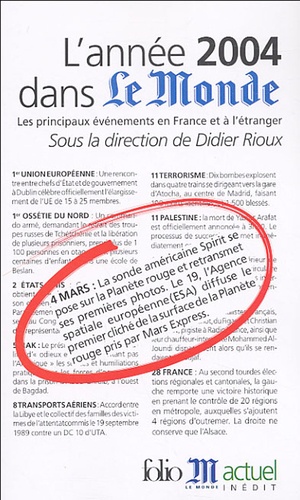
Histoire internationale
L'année 2004 dans Le Monde. Les principaux événements en France et à l'étranger
02/2005
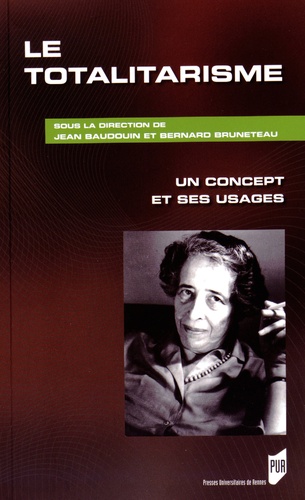
Sciences politiques
Le totalitarisme. Un concept et ses usages
12/2014

Histoire ancienne
Militaria de Lugdunum. Etude de l'armement romain et de l'équipement militaire à Lyon (Ier s. av. - IVe s. ap. J.-C.)
07/2019
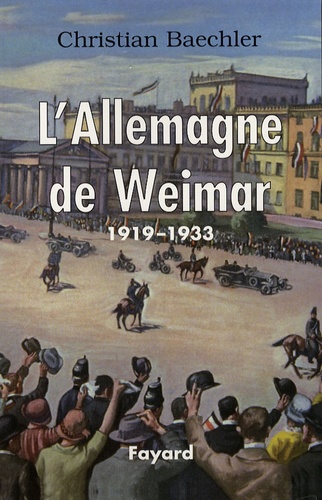
Histoire internationale
L'Allemagne de Weimar. 1919-1933
05/2007
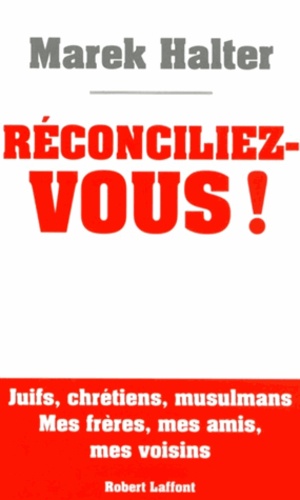
Religion
Réconciliez-vous !
02/2015
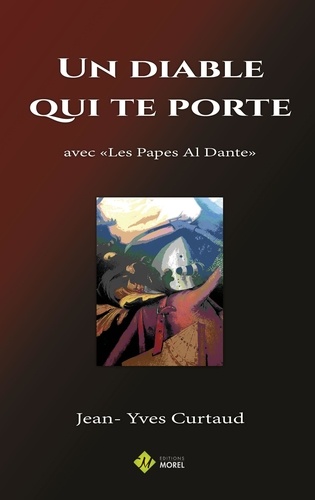
Histoire de France
Un diable qui te porte. avec "Les Papes Al Dante"
10/2020

Philosophie
L'Ame des Lumières. Le débat sur l'être humain entre religion et science : Angleterre-France (1690-1760)
10/2013

Histoire de France
Nouvelle histoire du Premier Empire. Tome 3, La France et l'Europe de Napoléon 1804-1814
08/2007

Droit
Manuel de procédure fiscale. 3e édition
12/2019
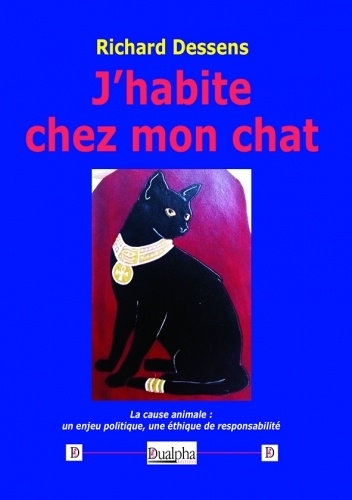
Littérature française
J'habite chez mon chat. La cause animale : un enjeu politique, une éthique de responsabilité
01/2021
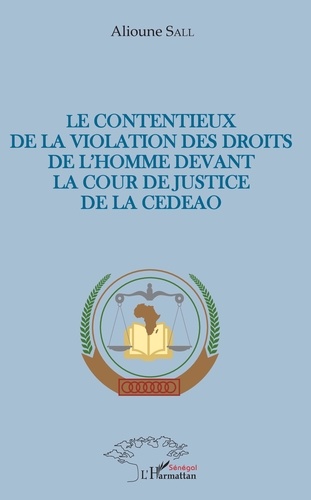
Droit
Le contentieux de la violation des droits de l'homme devant la cour de justice de la CEDEAO
07/2019

Actualité médiatique internati
Résister à tout prix. Conversations au coeur du conflit
11/2022

questions militaires
Le Führer et le Duce. Volume 2, L'Axe imaginaire : une guerre ni préparée ni dirigée
02/2021
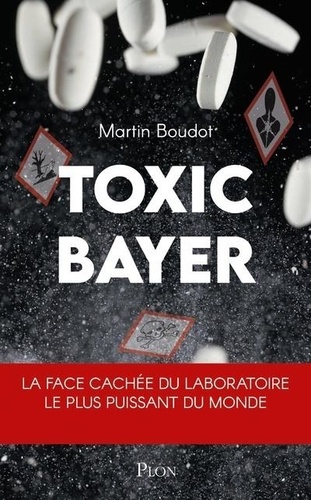
Actualité et médias
Toxic Bayer
10/2020
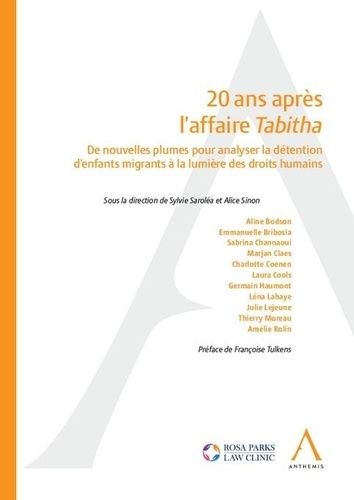
Europe et Droits de l'homme
20 ans après l'affaire Tabitha. De nouvelles plumes pour analyser la détention d'enfants migrants à la lumière des droits humains
07/2021
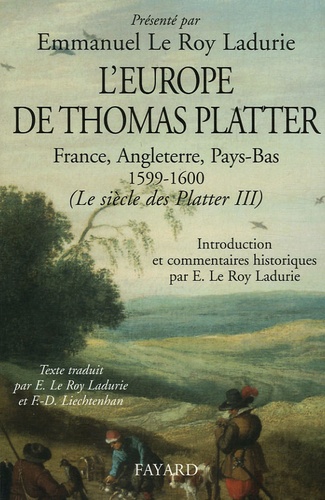
Histoire internationale
Le siècle des Platter. Tome 3, L'Europe de Thomas Platter, France, Angleterre, Pays-Bas 1599-1600
01/2006

Droits des étrangers
Droit des étrangers / droit de l'asile : entre attraction et répulsion. Actes du colloque de l'Université d'Evry (Université Paris-Saclay) du 4 mars 2020
08/2021
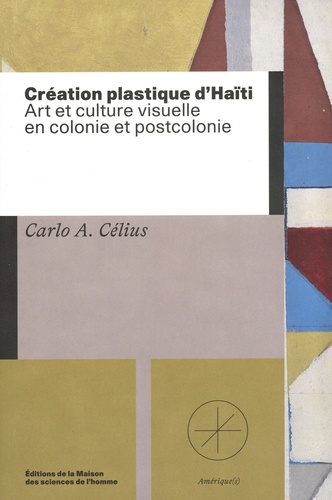
Histoire de l'art
Création plastique d'Haiti. Art et culture visuelle en colonie et post colonie
05/2023
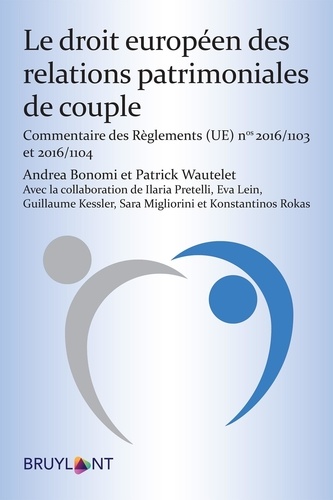
Couple, divorce
Le droit européen des relations patrimoniales de couple
03/2021

Ouvrages généraux et thématiqu
Les fruits de la terre
09/2023
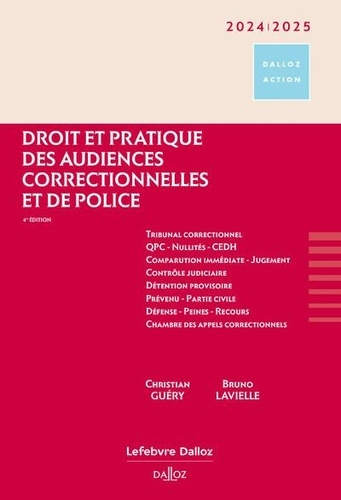
Police
Droit et pratique des audiences correctionnelles et de police 2023/24. 4e éd.
10/2023

Revues
Europe N° 1106-1107-1108, juin-juillet-août 2021 : La marionnette aujourd'hui
06/2021

Histoire littéraire
L'Harmonica de verre et miss Davies. Essai sur la mécanique du succès au siècle des Lumières
03/2021
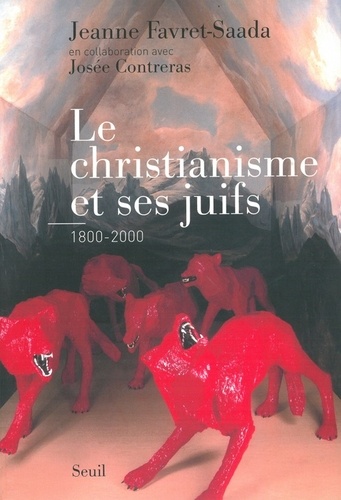
Religion
Le christianisme et ses juifs (1800-2000)
05/2004
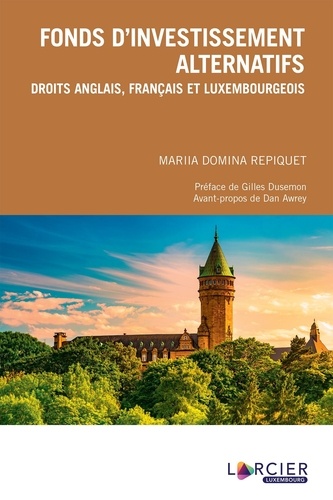
Droit comparé
Fonds d'investissement alternatifs. Droits anglais, français et luxembourgeois
07/2021

Histoire régionale
Histoire de la réunion de la Lorraine à la France. Tome 2
09/2023
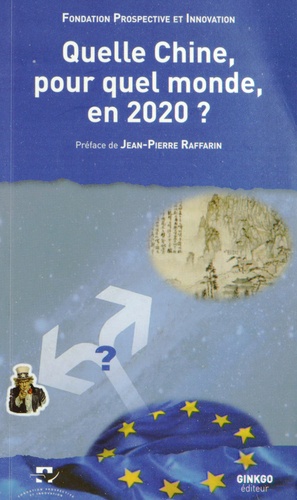
Sciences politiques
Quelle Chine, pour quel monde, en 2020 ? Colloque du Futuroscope, 30 août 2013
09/2014


