budget manifestations
Extraits
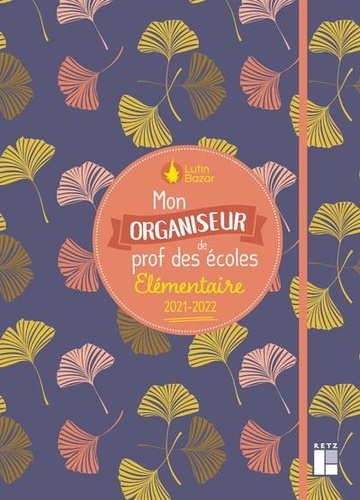
Pédagogie
Mon organiseur de prof des écoles élémentaire. Edition 2021-2022
06/2021
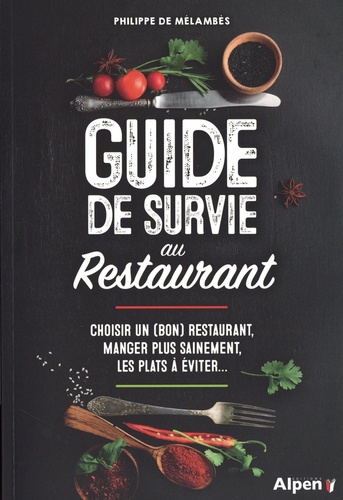
Essais - Témoignages
Guide de survie au restaurant. Choisir un (bon) restaurant, manger plus seinement, les plats à éviter...
05/2021
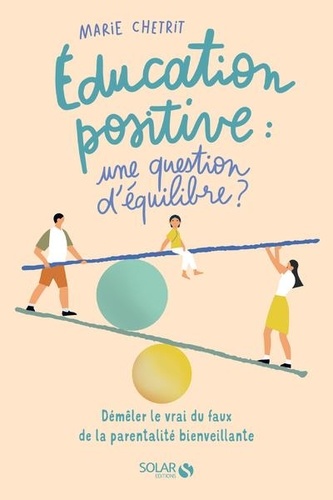
Education de l'enfant
Education positive : une question d'équilibre ? Démêler le vrai du faux de la parentalité bienveillante
10/2021
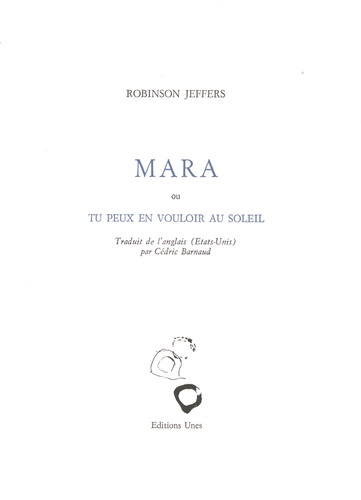
Poésie
Mara ou Tu peux en vouloir au soleil
06/2022

Beaux arts
Pop art in Belgium ! Un coup de foudre, Edition bilingue français-néerlandais
11/2015
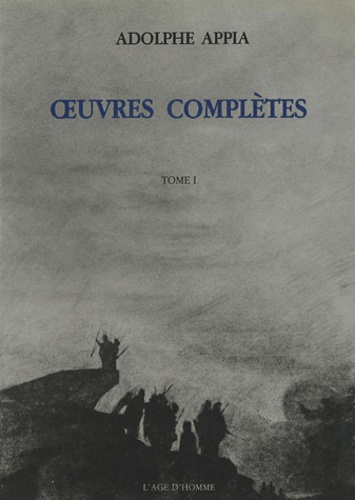
Philosophie
Adolphe Appia, Oeuvres complètes. Tome 1, 1880-1894
10/1983
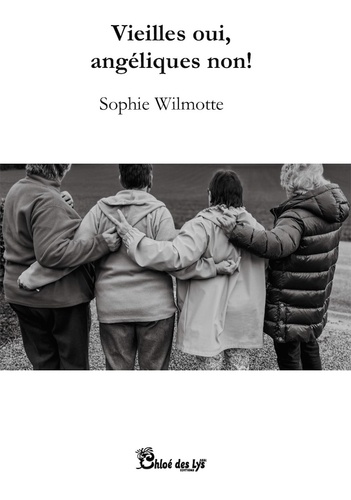
Littérature française
Vieilles oui, angéliques non!
05/2023
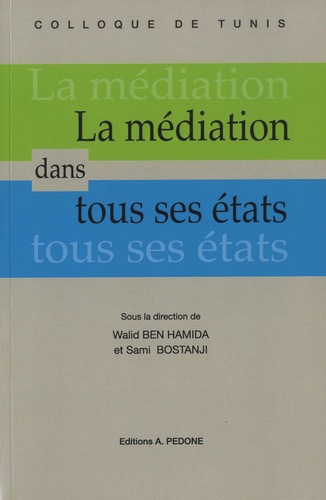
Droit
La médiation dans tous ses états. Actes du colloque international organisé à Tunis, les 9 et 10 mars 2017
06/2018

Correspondance
Au présent de tous les temps. Correspondances
05/2022
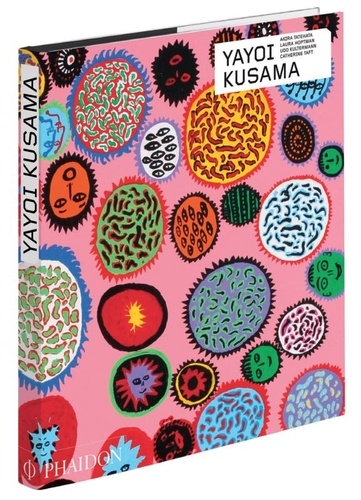
Beaux arts
Yayoi Kusama
10/2017
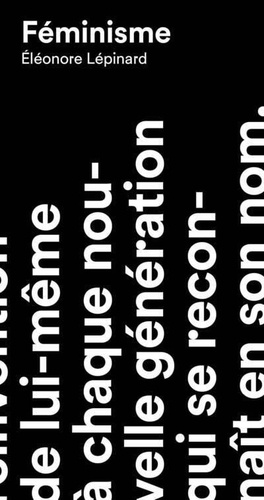
sociologie du genre
Féminisme
02/2024
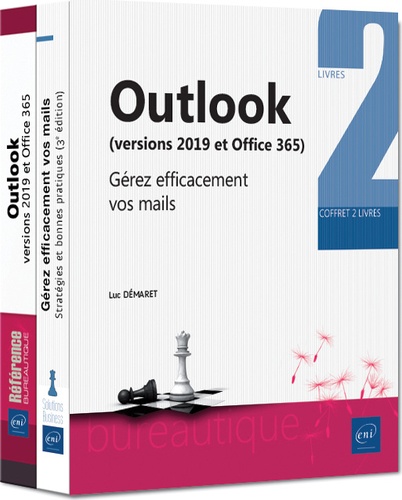
Informatique
Outlook (versions 2019 et Office 365). Coffret en 2 volumes : Gérez efficacement vos mails
08/2019
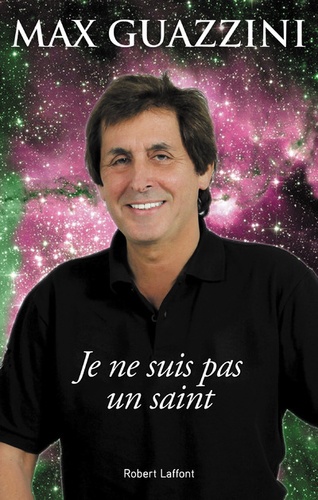
Sports
Je ne suis pas un saint
03/2017
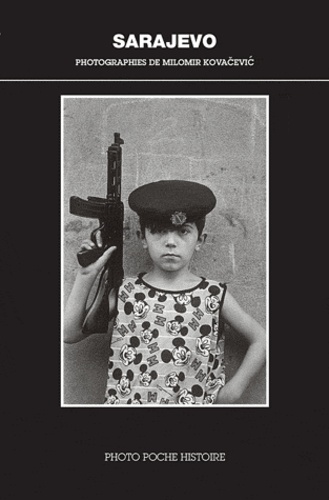
Photographie
Sarajevo. Ma ville, mon destin
11/2012
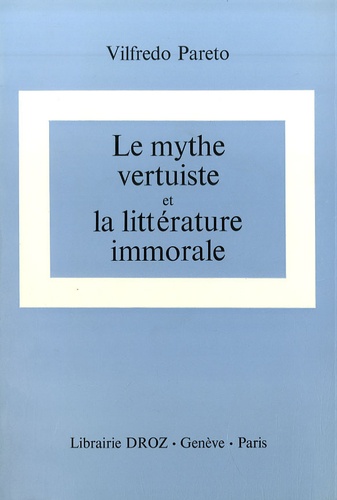
Sociologie
Oeuvres complètes. Tome 15, Le mythe vertuiste et littérature immorale
01/1971
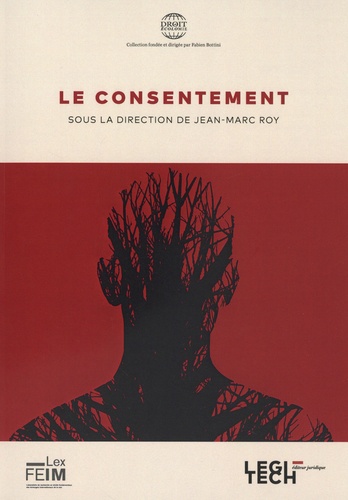
Droit des personnes
Le consentement
12/2021
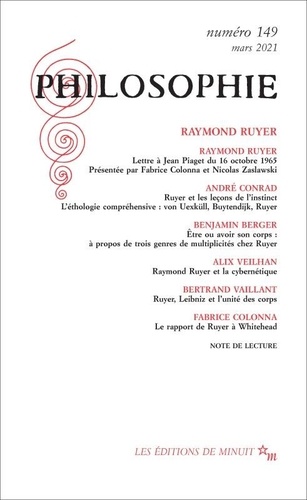
Autres
Philosophie N° 149, mars 2021 : Raymond Ruyer
03/2021
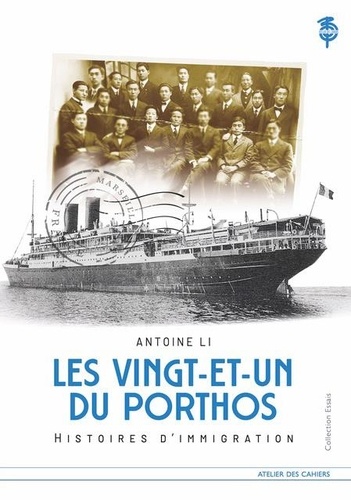
Immigration
Les 21 du Porthos
04/2023
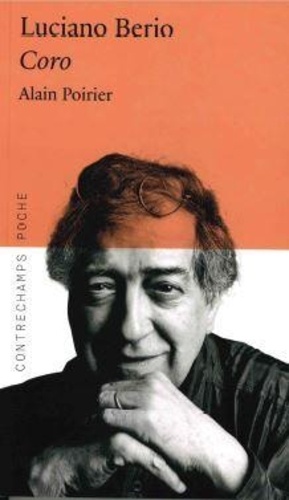
Compositeurs
Luciano Berio. Coro
03/2023
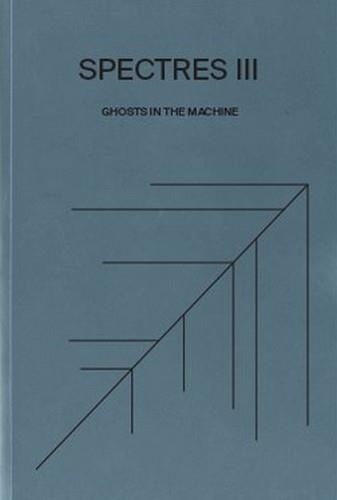
Musique
Spectres n° 03. Fantômes dans la machines
10/2021
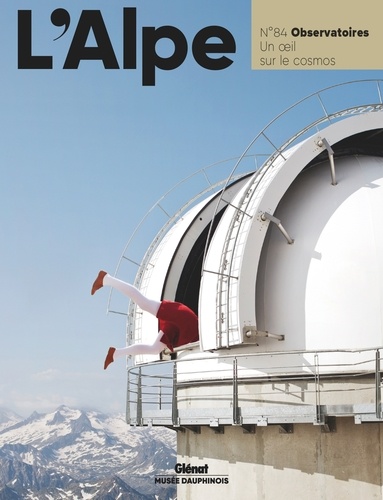
Sciences de la terre et de la
L'Alpe N° 84, printemps 2019 : Observatoires. Un oeil sur le cosmos
03/2019
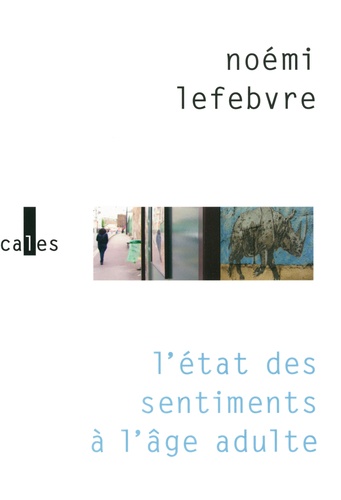
Littérature française
L'état des sentiments à l'âge adulte
02/2012
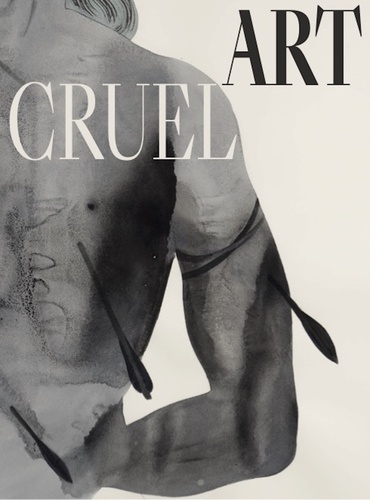
Art contemporain
Art Cruel
04/2022
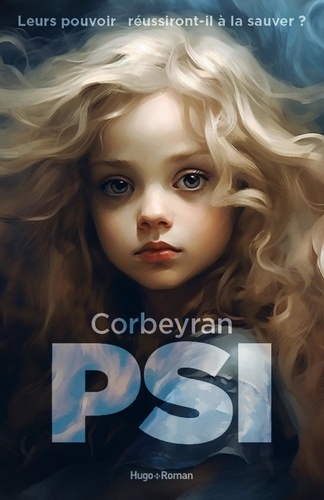
Fantastique
Psi
10/2023
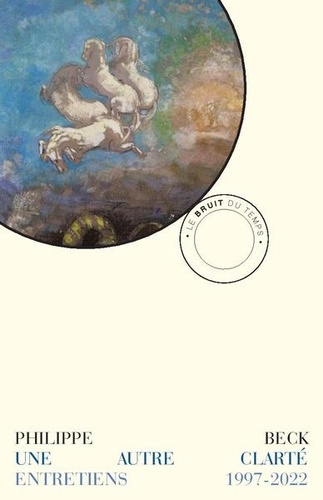
Littérature française
Une autre clarté. Entretiens 1997-2022
03/2023
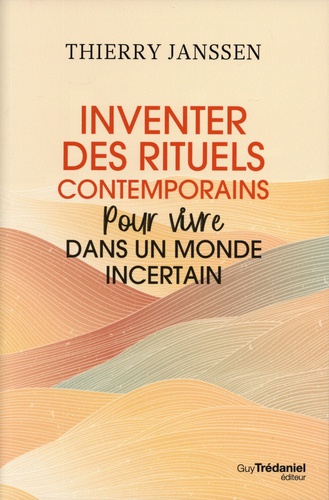
Connaissance de soi
Inventer des rituels contemporains. Pour vivre dans un monde incertain
05/2023
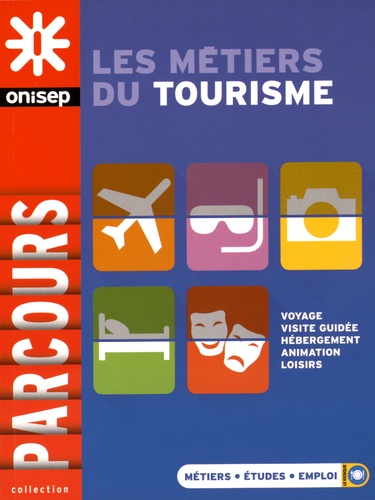
Développement personnel - Orie
Les métiers du tourisme
11/2015
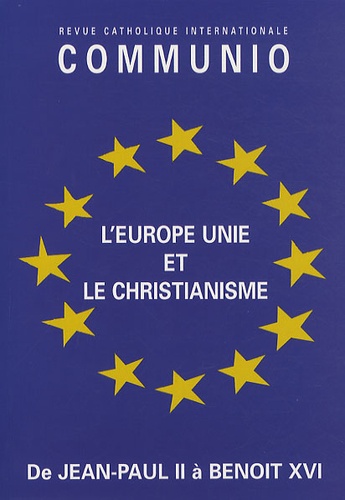
Religion
Communio N° 179 : L'Europe unie et le christianisme
06/2005
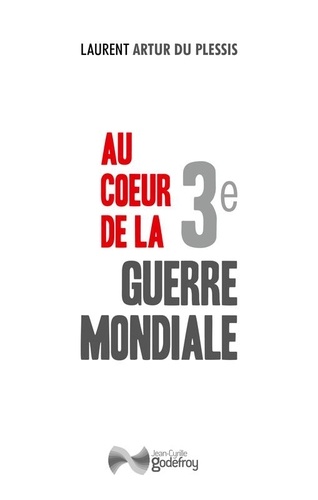
Actualité politique internatio
Au coeur de la troisième guerre mondiale
02/2024

Histoire régionale
Angoulême BD. Une contre-histoire (1974-2024)
02/2024

