Mécaniques du chaos
Daniel Rondeau
Pour Noëlle,
pour Habiba (la vraie !)
et ses compagnons d’infortune
« En étrange pays dans mon pays lui-même »
Louis ARAGON, La Diane française
« Ah ! sachez-le : ce drame n’est ni une fiction, ni un roman.
All is true, il est si véritable que chacun peut en reconnaître
les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. »
Honoré de BALZAC, Le Père Goriot
PREMIÈRE PARTIE
Petit monde
Les Tamaris, La Marsa, Tunisie
Je connais personnellement presque tous les personnages de l’histoire que vous allez lire. Les courbes de leurs vies ont un jour ou l’autre croisé la mienne. Pas de hasard ! Le destin avait préparé le carton de ma tapisserie. Je n’ai eu qu’à lancer le va-et-vient. Un kaléidoscope est apparu. Visages, villes, maisons, rivages. Les derniers paysages de ma vie. Des voix sont sorties de cette confusion, elles lui ont donné une sorte d’unité indéfinissable. Aujourd’hui, Habiba est celle qui parle au plus près de mon cœur.
2
Temple de Mnajdra, Malte
Elle ouvre les yeux, se parle à voix haute : « Je suis Habiba et je vis », et elle entend sa voix.
Déjà trois jours que la mer les a jetés sur les rochers. Hier après-midi, après avoir traîné son frère du rivage jusqu’à la grotte qui allait devenir leur abri, elle s’est écroulée. Pour la première fois depuis le naufrage, elle a dormi. Quand elle se réveille, elle entend son frère gémir. Il respire mal, inconscient, recroquevillé sur un tapis d’herbe.
Depuis combien de temps n’a-t-elle rien mangé ? Son dernier repas, c’était la veille de leur départ, à Tripoli. Du pain, du sucre et plusieurs portions de Vache qui rit. Hier, elle a cueilli quelques figues sur des cactées dans la lande. Pour tromper la faim, elle a mâché des algues et du fenouil sauvage. Une bouteille d’eau minérale jetée à peine entamée par un randonneur lui a permis d’étancher sa soif et d’apaiser celle de son frère, qui frissonne de fièvre.
Elle a les doigts écorchés, une entaille au poignet droit, la tête lui tourne, elle tremble, mais miracle du sommeil : se lever, marcher, sortir de la caverne, respirer, regarder la mer, tout lui paraît presque simple. Je suis une morte qui marche et qui parle.
La main sur la bouche, un peu abasourdie, elle s’assied sur une pierre face à l’intensité de la nuit. L’ombre est tissée de phosphorescences d’un bleu très dense qui enveloppent les creux des ravins, le miroir des eaux, l’immensité du ciel.
Chaque parcelle de roche, sur cette rive qu’elle ne connaît pas, lui semble familière.
La nuit, les étoiles, les pierres sont devenues des amies.
Ses pensées escaladent le ciel et vagabondent vers les astres. Elle aperçoit son père, décédé depuis longtemps. Allongé sur des coussins, il pince les cordes d’un luth et fredonne une berceuse. Il lui sourit. Mon père me voit, c’est pour moi qu’il chante, il me rassure comme il le faisait autrefois, quand j’avais peur, avant de m’endormir. Je n’ai plus peur, je suis Habiba et je vis et je chante avec mon père.
Elle regarde les paumes de ses mains, les trouve aussi claires que des lampes, ça la rassure. Elle les porte à ses lèvres ; elle embrasse ces mains qui ont arraché son frère à la mer. Je suis Habiba et je vis. Et lui aussi il vit, Dieu soit loué.
Depuis combien de temps a-t-elle quitté le village de ses ancêtres ? Pourra-t-elle un jour remonter le courant de la vie et revoir sa mère qu’elle a laissée derrière elle ? Elle se souvient d’une chanson de Michael Jackson. Billie Jean…Un de ses cousins lui avait montré sur son portable la vidéo du chanteur. Elle s’était entraînée à reproduire le pas du moonwalk. Elle y arrivait presque à la perfection quand son père l’avait surprise en train de danser derrière la maison. Lui qui n’élevait jamais la voix était entré dans une colère terrible et avait chassé son cousin à coups de bâton.
Elle ne sait pas si c’est un bon souvenir.
L’air de Billie Jean s’installe dans sa tête.
La Méditerranée respire lentement. Tellement paisible…
Habiba recommence à trembler.
La peur est revenue. Elle lui fouille le ventre. Soudain elle pousse un cri. Elle revoit les horreurs qu’elle a endurées sur le bateau depuis le moment où la mer, labourée par des vents contraires, avait commencé à prendre un visage inquiétant. C’était la nuit. Ils dérivaient depuis quatre jours et avaient épuisé leurs réserves d’eau. Quelqu’un a crié que la côte était proche et que le jour n’allait plus tarder. Les deux moteurs Yamaha du dinghy étaient noyés.
Hagards, hébétés, brûlés par le soleil et le sel mais tremblants de froid, giflés à chaque instant par des paquets de mer, les voyageurs se sont blottis les uns contre les autres. Ils chiaient tous dans leurs culottes. La peur. L’odeur de la merde était devenue plus forte que celle de la mer. Beaucoup essayaient encore de croire qu’ils allaient bientôt quitter leur radeau en caoutchouc et poser le pied sur la terre d’Europe, ce n’était qu’une question de patience. Il fallait encore un peu de courage. Certains priaient à voix haute. Tous ceux qui ne pleuraient pas.
En quelques instants, leur situation était devenue intenable. Les vents venaient encore de forcir et barattaient la mer dans tous les sens. Les vagues se creusaient en rugissant, enflaient par soubresauts, montaient vers le ciel, soulevaient le dinghy dans des geysers d’écume, puis le rejetaient avec violence, l’écartelant à chaque fois dans leurs creux. Il avait suffi de quelques vagues, plus violentes encore, et Habiba avait vu ses compagnons éjectés par-dessus bord.
Disparus.
Elle se demande comment elle a échappé aux flots. Et son frère ? Qui leur a donné cette force ? Le Miséricordieux ? Les Sept Dormants ?
Cachée entre des rochers, son frère blessé auprès d’elle, à bout de forces, paralysée par la fatigue et l’angoisse, à demi inconsciente, elle a vu l’hélicoptère hélitreuiller des cadavres et les déposer sur une route où stationnaient des ambulances.
Des chiens couraient. Ils se rapprochaient.
La veille, en fin d’après-midi, elle a trouvé la force de les caillasser. Une pierre plus lourde que les autres a touché un bâtard épais au poil fauve, court sur pattes, le plus agressif de la petite meute. Crève ! Barre-toi charognard ! Crève ! Il avait roulé sur le sol en couinant, un long aboiement plaintif, puis s’était éloigné, la queue basse, suivi par ses compagnons.
Elle ferme les yeux.
Saloperies de chiens…
Calme-toi, tu es Habiba et tu vis.
3
Les Tamaris, La Marsa, Tunisie
Je m’appelle Sébastien Grimaud, je suis un archéologue qui pour l’instant se tient un peu à distance de ses chantiers. J’ai reçu la visite, au début de l’hiver, du fils d’un officier turc qui m’avait aidé autrefois quand je fouillais le site d’Éphèse. Il m’a poussé sans le savoir à reprendre mon carnet de notes.
J’avais rencontré ce militaire au début des années 80, à l’aéroport d’Istanbul, il rejoignait sa famille sur les rives du lac Tuz pour les vacances. Le trafic, pour une raison que j’ai oubliée, était fortement perturbé. Plusieurs avions, dont le nôtre, avaient plus de cinq heures de retard, nous avions sympathisé, malgré mon peu d’estime pour le régime qu’il servait.
J’observe mes semblables, je leur pose des questions et j’écoute leurs réponses avant de les juger. Cette forme de sagesse n’a longtemps été qu’une conséquence de ma timidité. Dans ma jeunesse, j’étais d’un caractère renfermé, trop passif pour intéresser les membres de ma famille. Longtemps les gens ont pensé que je n’étais pas de bonne composition. Plus tard, ils ont prétendu que j’étais snob. En fait, j’hibernais dans ma peau d’enfance, ne m’éveillant que face au miroir des labours où je cherchais après la pluie des éclats de silex ou des pointes de flèches, ou en rampant dans les couloirs d’accès aux chambres sépulcrales de la vallée du Petit Morin, des grottes délaissées par les visiteurs au pied d’un coteau.
Les questions que je n’osais pas poser à mes contemporains, parents ou amis, je les posais à ces inconnus qui, quelques milliers d’années auparavant, avaient creusé des puits de silex avec des bois de cerf dans les épaisseurs de la craie.
Cette conversation permanente avec les morts m’a aidé à entrer dans l’éreintante complexité des vivants. Heureusement, je n’ai découvert que tardivement cette phrase de Shakespeare qui me perturbe de façon rétrospective : « Maudit soit celui qui dérange mes os. » Si je l’avais connue plus tôt, je le crains, toute mon existence en aurait été changée.
L’aéroport d’Istanbul, à l’époque de ma rencontre avec Demir, était de dimensions modestes, malgré une activité internationale déjà importante. Un grand désordre régnait d’ailleurs dans le terminal où nous avions été invités à patienter. Il n’y avait pas assez de sièges pour tout le monde et beaucoup de voyageurs étaient assis par terre ou sur leurs valises. Des Américains, des Allemands, mais aussi des hommes d’affaires turcs. Des musulmans bulgares, plus ou moins chassés de chez eux, affalés dans une odeur de bouc sur des monceaux de bagages disparates et mal ficelés, formaient un groupe compact au centre du hall.
Des garçons en fez et en gilet ottoman avaient fini par nous proposer du thé et de grands plateaux de yaourts frais. Mon voisin m’avait observé par-dessus son épaule finir mon yaourt en hochant tristement la tête. Il avait sorti de son sac une flasque de whisky et m’avait tendu son gobelet. J’avais accepté, il s’était présenté : « Colonel Demir… » Je n’avais pas imaginé que cet homme aimable, francophone, portant des vêtements décontractés, pût appartenir à la junte alors au pouvoir à Ankara.
Plus tard, il m’avait présenté sa famille et m’avait rendu très souvent visite avec ses enfants, dont Levent (j’ai encore l’écho de son rire dans ma mémoire), sur des chantiers de fouilles qu’il avait favorisés en bousculant la lenteur et les réticences administratives des fonctionnaires des Antiquités turques. Il nous a ouvert tellement de portes qu’avec l’accord tacite de mes supérieurs, je lui ai offert un buste romain de l’Antiquité tardive, copie d’époque d’une statue célèbre. Nous sommes restés longtemps en contact, avant de nous perdre de vue.
Quel choc quand son fils s’est présenté à ma porte, il y a quelques mois. J’ai poussé un cri de surprise au moment où Rim, qui vit chez moi, est venue me dire qu’un certain monsieur Demir souhaitait me parler. Demir ! Quand j’ai vu Levent, pendant quelques secondes, j’ai vraiment cru que c’était son père. Même grain de peau, cheveux courts plantés de la même façon, des mocassins Timberland (j’ai tout de suite imaginé qu’il avait gardé les contacts de son père à Washington), le même timbre de voix.
« Mais comment m’as-tu trouvé ? Tu es venu d’Istanbul jusqu’ici pour me voir ? »
Il ne venait pas de Turquie mais de Libye. Des archéologues libyens lui avaient parlé de moi et lui avaient indiqué que je vivais ici, près de Tunis. « Tu arrives de Benghazi, en voiture ?
— Je suis parti hier soir, ça roulait bien, si je n’avais pas été bloqué bêtement au poste frontière… »
Je me doutais qu’il lui faudrait un peu de temps pour me parler du but de sa visite.
Je l’ai emmené déjeuner sur une terrasse en plein vent, près du port. Nous avons partagé une carafe de vin blanc et des filets de sardines crues. Je me concentrais sur ce que je mangeais en attendant qu’il se lâche. La chair des sardines était nacrée, d’un blanc très pur avec des reflets bleus. Au moment où j’ai demandé les cafés et l’addition, j’ai cru qu’il allait se livrer, mais ce n’est que tard dans la soirée qu’il est entré dans le vif du sujet en évoquant la situation en Libye où il séjournait fréquemment.
« Il n’y a plus d’État, plus d’institutions, la guerre civile fait rage…
— Les islamistes sont en train de prendre le contrôle du pays.
— Mon gouvernement cherche à apporter sa contribution à la stabilisation de la région… Et comme vous le savez, certains groupes ont commencé à détruire le patrimoine national. Les mosquées de la vieille ville de Tripoli, mais aussi les monuments de ces deux extraordinaires cités romaines qui avaient résisté à presque tout…
— Qu’est-ce que tu attends de moi ?
— Certains responsables libyens pensent qu’il vaut mieux faire sortir du pays un certain nombre de ces trésors plutôt que de les détruire… »
J’avais compris. Levent était bien le fils de son père.
En Irak et en Syrie, le trafic d’antiquités était, avec le pétrole, l’une des principales sources de revenus des islamistes. Ce qu’ils ne démolissaient pas, ils le vendaient. Levent était venu demander mon assistance et mon expertise pour l’aider à mettre en place en Libye un réseau du même genre. Je lui ai demandé un peu de temps pour réfléchir et pour qu’il m’organise quelques contacts exploratoires. Rim lui a préparé la chambre d’amis, il est reparti le lendemain matin.
Levent avait poussé ma porte à un moment où ma vie prenait un nouveau départ. Les chèques que je recevais depuis trois ans de mon éditeur avaient hâté mon éloignement du CNRS et m’avaient fait renoncer à deux ou trois chantiers de fouilles d’urgence, comme celles que j’avais l’habitude de mener chaque hiver depuis vingt ans, souvent loin de mes bases habituelles. Le succès inattendu de mon livre sur Alexandre le Grand avait bousculé le cours de mes jours.
Cet Alexandre, commande d’un éditeur scientifique de la rue des Écoles, je l’avais rédigé à partir de notes très anciennes. Ouvrage court, composé d’un journal de fouilles, agrémenté de réflexions personnelles, et enrichi de citations d’historiens grecs, persans ou arabes. Le genre de livre qui ne dépasse généralement pas les trois cents exemplaires. Mais une radio m’a demandé de l’adapter en « micro-récits » de sept minutes, diffusés quotidiennement pendant l’été. Décollage immédiat, libraires dévalisés, édition de poche promise au même succès, traductions.
Je n’ai pas hésité. Ma mère venait de mourir, j’avais fermé sa maison et l’avais mise en vente. Mon pays me fatiguait. Mes contemporains aussi. Ils réussissaient l’exploit d’être à la fois dépressifs et arrogants, s’abandonnaient à des politiciens médiocres. J’avais l’impression que le monde dans lequel j’avais grandi, avec ses points fixes et ce qu’on appelait ses mœurs, tout ce que j’avais pu trouver insupportable autrefois, était en train de disparaître sous mes yeux. Il m’arrivait de le regretter.
Ma « carrière » scientifique approchait de son terme, j’ai tourné le dos aux fossoyeurs, anticipé la guillotine de la retraite et je suis venu m’installer ici.
Quitte à vivre au milieu des ruines, autant choisir les siennes.
J’ai acheté Les Tamaris, une maison à La Marsa, près de Tunis. Non loin du rivage, dans une zone incertaine, sur les pointillés de cette frontière qui, tout autour de la Méditerranée, sépare l’argent de la misère. Et le passé du présent. Où puis-je me sentir chez moi ? demandait Nietzsche. Dans cette énorme baraque mauresque, un peu pouilleuse, humide en hiver, je me sentais chez moi, pour la première fois.
J’ai soixante-deux ans, je suis mince, taille moyenne, le cheveu noir, une énergie encore disponible, je mange, je bois, je bande, seulement quelques poils blancs dans la barbe, et c’est sur les pointillés de cette terre tunisienne que je vais vivre la nouvelle saison de mon âge. Nouvelle ou dernière ? C’est la question que m’a posée Levent, qui a aussi hérité de l’ironie de son père.
L’extérieur de la maison ne paie pas de mine. On est loin des villas patriciennes du quartier, entourées de bougainvillées, et gardées par des hommes en noir, reliés jour et nuit à leurs maîtres par des oreillettes. Rien d’ostentatoire donc, mais un reste d’élégance dans la façade décrépie, graffitée au goudron d’un vigoureux : BEN ALI DÉGAGE ! Le terrain vague qui descend vers le port, royaume de chats faméliques, est constellé d’immondices et de bois flottés. J’entretiens le flou. Des artisans tunisiens se sont
occupés de rénover l’intérieur. Je n’ai pas lésiné et je me suis fabriqué un décor dépouillé et confortable.
De ma chambre au premier étage, j’entends les allées et venues de mon voisin. Il vit de la pêche et de son jardin. Le moteur de sa barque me sert d’horloge. Rim est venue habiter avec moi quelques semaines après mon arrivée. Comme tous les jeunes gens livrés à eux-mêmes, elle se réveille tard. J’ai toutes mes matinées pour écrire.
4
Ankara, Turquie
Levent aurait pu se rendre à Kobané en hélicoptère, mais il a préféré conduire. Au moment de quitter Ankara, avant le lever du soleil, il a même donné congé au garde du corps qui avait préparé la Range Rover, rempli des jerricans de secours. « Prends ta journée, je n’ai pas besoin de toi… » En passant devant le lac Tuz, suivant des yeux un envol de flamants roses, il se souvient être venu là en vacances avec son père (ensuite ils partaient tous chaque année passer quelques semaines en Floride).
Proche du général Kenan Evren, lié aux Américains, son père travaillait pour les services secrets, comme lui. Sous couvert de kémalisme, il coopérait avec la CIA. La roue tourne, mon père combattait l’islamisme, moi je le soutiens, pour l’instant, chaque génération doit s’adapter à ce qui vient, il a eu du bon temps lui aussi, et nous en a fait profiter. Maintenant c’est à moi de jouer… Ses pensées vagabondent, la route est longue.
Il pense à son rendez-vous de demain. Sa curiosité est piquée, plus qu’il ne se l’avoue, à l’idée de rencontrer ce nouveau cadre dirigeant de l’État islamique, dont tout le monde dit que c’est un formidable spin doctor. Il se souvient de ses amis du Pentagone qu’il ne voit plus aussi souvent, même s’ils restent en contact étroit, puis il refait mentalement l’estimation de tous ses comptes offshore (au Luxembourg, à Singapour…). Ces supputations quotidiennes, sa distraction préférée, le mettent à peu près dans le même état que les messages porno que lui envoient régulièrement les putains russes qu’il rencontre à chacun de ses séjours à Istanbul. Il essaie de chiffrer ce qu’il va laisser à ses deux garçons, quand il partira. Le plus tard possible, j’espère… Inch’Allah. J’ai encore de belles années devant moi. Normalement ses deux fils seront à l’aise jusqu’à la fin de leurs jours. Et leurs enfants aussi.
Comme certains hommes à la vie chaotique, Levent se rassure en cherchant précision et cohérence dans l’organisation de son quotidien. Chaque chose doit être à sa place. Un ordre rigoureux préside aux affaires qui ressortent à sa vie privée. C’est ainsi qu’il a exigé de recevoir (sur un téléphone codé et deux fois par jour) la position exacte de tous ses comptes à l’étranger.
Les spéculations sur sa fortune le ramènent, dans un enchaînement presque parfait, au souvenir de sa dernière rencontre avec Katiocha (ses petites fesses rondes… du marbre chaud… On dirait une sculpture. Il faut que je la revoie, je dois l’emmener ailleurs, Istanbul, une fois, ça va, avec ces Russes, qui ne pensent qu’à se faire du fric, je dois rester prudent… Une manip est toujours possible…). Le va-et-vient de ses pensées, le fric, le sexe, le sexe, le fric, tous les scénarios plausibles qu’il envisage le détendent. Il se sent en forme, secoué à intervalles réguliers par de puissantes montées d’adrénaline qui lui procurent un sentiment de bien-être. En doublant un long convoi militaire qui se dirige comme lui vers la frontière, il se demande s’il ne pourrait pas l’emmener à Malte, lors de sa prochaine mission. On prendrait le ferry à La Valette, la traversée dure moins de deux heures et on filerait en Sicile. J’ai cinquante-huit ans, dans dix ans, les filles… Et celle-là, quel cadeau… ! Le Prophète lui-même en serait dingue s’il voyait se dresser ses tétons…
Levent commence machinalement à se branler, puis renonce. Il roule vite jusqu’à Adana, peu de circulation, mis à part les interminables cortèges qui se dirigent vers la frontière.
Il se demande combien de missions encore il devra effectuer en ayant l’impression de marcher sur un fil au-dessus du vide. Ce n’est pas la première fois qu’il pense au moment où il décrochera. Aujourd’hui, le service a du cash, un maximum de cash, les événements nous donnent une marge de manœuvre inespérée… Erdogan a besoin de moi… je suis une pièce non négligeable dans son jeu… mais quand même… je donne quelques sucreries aux Américains… On coopère avec les islamistes… pour l’instant, tout cela n’est pas de tout repos… il faut savoir jongler… je sais, ça arrange tout le monde… sauf ces connards de Kurdes… tant que ça durera… Les premiers embouteillages apparaissent à l’entrée d’Adana, après plusieurs heures de route.
Il fait le plein, s’arrête à une terrasse pour fumer une cigarette et s’offrir une brochette d’agneau, avec un verre de jus de navet fermenté, puis repart. Levent s’abandonne à nouveau au ronronnement d’une circulation fluide. Heureusement que je suis parti seul, j’aurais eu ce crétin sur le dos pendant tout le trajet… La route traverse d’immenses champs d’orangers et de cotonniers, entrecoupés de cultures maraîchères.
Il met un temps fou à traverser Osmaniye qui s’allonge dans un encorbellement de collines. Ensuite, il lui faut encore près de cinq heures pour approcher enfin de Kobané, Ayn al-Arab comme ils disent, par une route pourtant large, au milieu de nulle part. Arrivé quasiment à destination,
Levent sort de la voiture et monte sur un talus pour observer la ville où Kurdes et djihadistes se battent au corps à corps depuis la fin de l’été.
De l’autre côté de la frontière, les derniers rayons du soleil empourprent la cité ravagée par des semaines de combats et de bombardements. Kobané semble proche, malgré sa ceinture de barbelés. Minarets miraculeusement debout, immeubles éventrés, maisons en ruines ou en feu, d’où montent d’épais panaches de fumée, taches vertes de quelques jardins sur l’ocre du sable, façades blanches. Des convois de troupes sillonnent la plaine en soulevant des nuages de poussière dans les champs moissonnés. Du côté turc, à vingt mètres de lui, des ambulances sirènes hurlantes se fraient un chemin au milieu d’une foule considérable.
Levent reste les yeux rivés sur cette population qui fuit les atrocités et a perdu tous ses repères. Vieillards courbés sur des bâtons, grappes d’enfants aux yeux grandis par la faim et la peur, paysannes en longue jupe, certaines portant leur enfant au sein, handicapés, mendiants, blessés et mutilés appuyés sur des béquilles de fortune, mais aussi, mêlés au flot continu de la misère, des petits marchands d’eau ou de fruits, de pain, des curieux et voleurs, des voyous fatalistes attendant leur heure, des dealers ou des prêteurs sur gages, costumes sales, joues mal rasées.
Levent apprécie cet instant qui lui donne l’impression d’être un homme debout dans les secousses de l’Histoire, à une place où rien ne viendra perturber sa liberté d’action et, d’une certaine façon, son confort. Je suis un guerrier nomade, mes ancêtres ont écumé les corridors des steppes pendant des siècles, avant de conquérir la nouvelle Rome, nous avons l’agilité et la force, je ne serai jamais comme ces gueux, la force est en moi, je bouge, je joue. Et je nique des poupées blanches.
Des combattants en armes, des journalistes, des photographes, des équipes de télévision venues du monde entier se mêlent aux hordes de réfugiés qui errent dans le labyrinthe des rues à l’arrière de la ligne de démarcation.
Depuis le début des combats, une autre ville est née et a grandi de ce côté-ci de la frontière.
Une mégapole à ras de terre, surgie du chaos.
De la boue et de la poussière.
Partout des campements, des feux, des montagnes d’ordures, des tranchées remplies de merde, de longues tentes de stockage paramilitaire, des nacelles rondes aux couleurs pastel fournies par des ONG, ou des abris bricolés avec des tapis et des couvertures tendus sur des armatures de branches. Beaucoup de réfugiés syriens. Plusieurs familles sont agenouillées dans la poussière et prient à voix basse. Des chrétiens…
À tous les check points, les masses vertes ou bleu foncé des militaires turcs. Ils contrôlent toutes les entrées et toutes les sorties.
De l’autre côté, la Syrie. On te baisera Bachar, on te pendra par les couilles…
Les passages se font au compte-gouttes.
Levent s’approche non sans peine d’un barrage et fait connaître sa qualité à un poste tenu par la police spéciale du président Erdogan. Immédiatement, un jeune lieutenant le conduit jusqu’à une villa isolée, sur les hauteurs, qui sert de quartier général aux officiers turcs qui passent la plupart du temps les yeux rivés à leurs jumelles. « Nous comptons les points et nous faisons des rapports, dit l’un d’eux à Levent. Mon commandant, dommage que vous ne soyez pas arrivé hier, la coalition était en action. Il est rare de pouvoir assister à des frappes aériennes dans de telles conditions. Les F-16 ont fait plusieurs passages dans la journée… très intéressant, je peux vous montrer les vidéos, mais aussi pas mal de paperasse en perspective, heureusement qu’ils ne tapent pas tous les jours… »
Il apprécie qu’on l’appelle commandant, bien qu’il n’ait aucun grade. Seulement un matricule dans le grand livre des services turcs.
Il dort dans la maison. Le capitaine lui a passé son lit. La nuit est courte. Le lendemain matin, un chauffeur en civil l’emmène jusque dans une autre villa, située à quelques kilomètres, à Suruç. Ici aussi, comme partout dans cette partie du monde, la vie quotidienne est bouleversée par la guerre. Villages de toile et alignements de cercueils au cordeau. Des bulldozers sont en train d’araser un terrain pour installer des préfabriqués et creuser des fosses communes. Déjà cinq camps de réfugiés, kurdes pour la plupart. Des camions de vivres attendent depuis plus d’une semaine au bord de la route l’autorisation de ravitailler Kobané.
La maison est vide, le propriétaire, patron d’une chaîne locale de supermarchés, a fui les combats. Le gardien, un vieil homme aux cheveux d’un blanc de neige, avec un bras en écharpe, lui prépare un café puis sort dans le jardin. À 9 heures précises, une voiture s’immobilise devant le portail. Le chauffeur se précipite pour ouvrir la porte du passager.
Levent assiste à la scène d’une fenêtre du premier étage, non sans une certaine excitation. L’apparition ponctuelle de ce personnage le conforte dans l’idée qu’il appartient, comme son visiteur, à la caste de ceux qui échappent aux lois de la vie ordinaire. L’homme, vêtu à l’occidentale, déploie une silhouette longiligne et presque maigre.
« Salam alikoum ! Très heureux de vous rencontrer. Appelez-moi Mourad, d’ailleurs c’est bien le prénom que vous m’avez donné pour mon passeport, non ? »
Il s’exprime dans un anglais correct, mais avec de curieuses intonations, en découpant des phrases courtes, de façon très articulée. Levent pense qu’il cherche à dissimuler son accent. Un visage ascétique, profil d’oiseau de proie, une brosse de cheveux noirs redressés vers l’arrière, la
quarantaine. Les services de Levent n’ont jamais réussi à trouver sa véritable identité. Seule certitude : d’origine irakienne, ancien officier de Saddam Hussein, il a rejoint les bataillons islamistes depuis plusieurs années et se présente aujourd’hui comme l’un des cadres de l’État islamique chargé de l’international, ce qui ne veut rien dire.
« Les formalités de douane n’ont pas été trop…
— … trop compliquées ? Certainement pas, grâce à vous, merci. J’ai bénéficié de documents de voyage irréprochables.
— Vous pourrez les réutiliser ce soir, en passant la frontière au même poste. Mais attention, vous portez une identité biodégradable. Demain, après sept heures du matin, si vous vous présentez avec ce document, vous serez arrêté sur-le-champ. »
Leur discussion dure trois heures. Les deux hommes sont en contact depuis longtemps mais c’est la première fois qu’ils se rencontrent. Mourad, très méthodique, conduit l’entretien qu’il envisage comme « un balayage assez général des dossiers chauds ». Il propose qu’ils s’accordent pour commencer sur le secret absolu qui doit entourer leur rencontre. « C’est un préalable, dit Mourad avec un sourire étrange. — On ne se connaît pas, acquiesce Levent. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Cette conversation n’a pas eu lieu. »
Commence aussitôt un échange d’informations très fouillé sur la Syrie, les intentions kurdes (« À ce sujet, nous apprécions que vous n’ayez pas fermé totalement le robinet des informations », dit Mourad sans sourire), l’Irak, le Mali, le Liban, l’Égypte, la Libye, et bien sûr Kobané. Les deux hommes restent aussi concentrés l’un que l’autre pendant qu’ils se parlent, d’un ton toujours égal, sans jamais se quitter des yeux.
Mourad, les jambes croisées, allume régulièrement une cigarette qu’il ne termine pas. Le nez busqué et fin, la bouche prise dans deux rides, la barbe taillée et brillante, il porte sur son visage émacié la suffisance de celui qui a survécu à plusieurs attaques de drones américains. En face de lui, Levent fait plus pataud, plus rond, paraîtrait même plus fragile (mais il en rajoute). Il écoute avec attention son vis-à-vis (il a appris à se taire pour faire parler les autres) et l’enserre dans le faisceau de ses yeux noirs, sans que cela l’empêche de poser par rafales des questions brèves et incisives, dont la précision bouscule parfois son interlocuteur.
Ni l’un ni l’autre ne prennent de notes.
Réseaux, financements, armement, relations avec les États « amis », tout y passe. Des informations générales, en masse, plutôt de nature politique. Évidemment, intox et mensonges sont au menu de leur « balayage croisé ».
Mourad n’hésite pas en passant à user de son art de la flagornerie, mais chacun de ses compliments ne réussit qu’à faire retentir un signal d’alerte dans le cerveau de Levent.
Ce sont deux chats qui s’observent, se reniflent, griffes sorties pour saisir ce qui se présente à leur portée, sans jamais cesser de chercher des points de convergence pour leurs intérêts communs. Leur dernier échange porte sur la Libye. Chacun a trouvé son compte dans cette conversation qui n’existe pas et chacun est en train de réfléchir à l’usage qu’il peut faire des renseignements glanés. Levent ouvre la fenêtre et demande au gardien dans le jardin d’apporter deux cafés. Avant qu’il n’arrive avec un plateau de plastique bleu, Mourad se lève et regarde la ville de Kobané qui brûle. Sans se retourner, il lance :
« Un détail encore. »
Jusqu’à présent, personne ne parlait de détails.
« Il me semble qu’il est temps de mettre en branle nos agents à Tripoli et à Paris.
Extraits




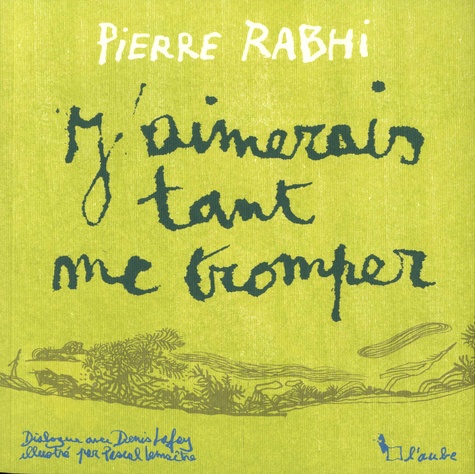
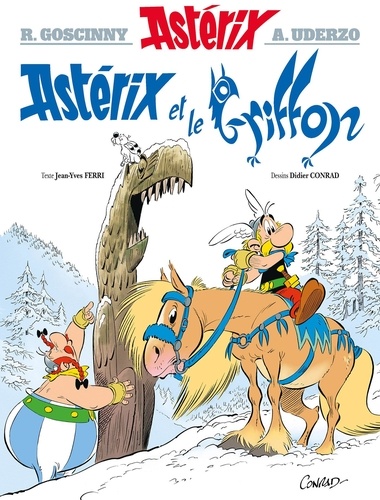
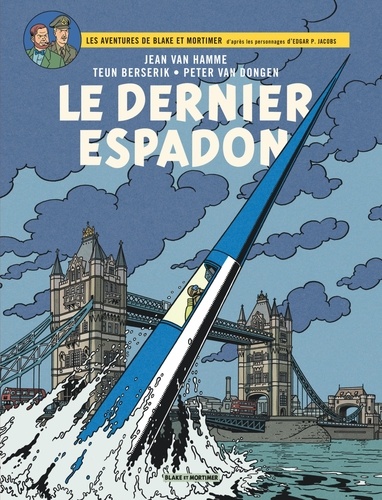
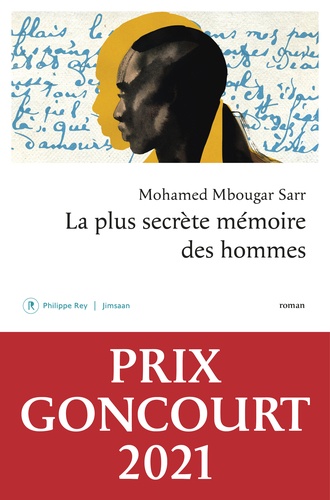
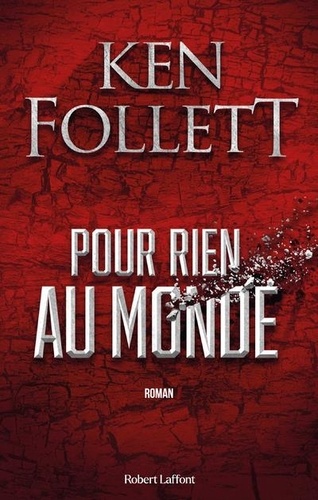
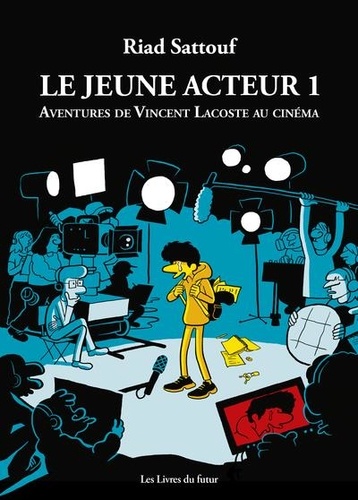
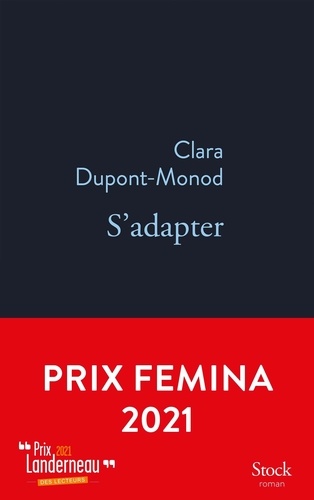
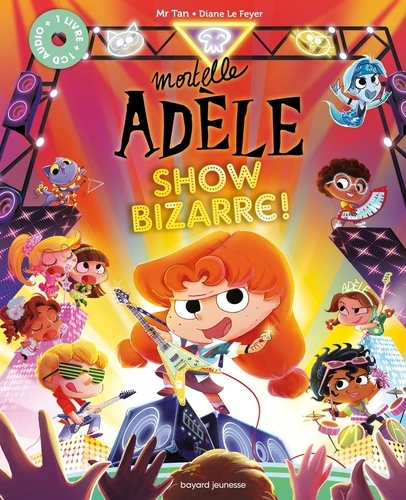
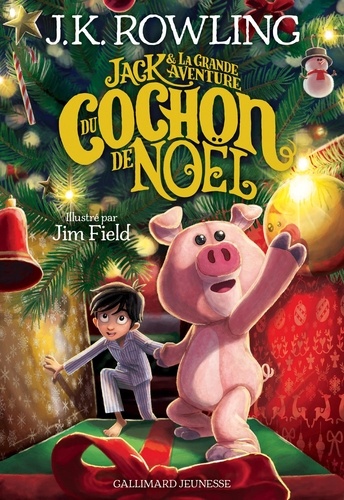
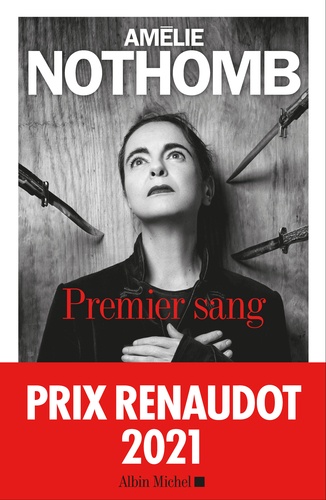

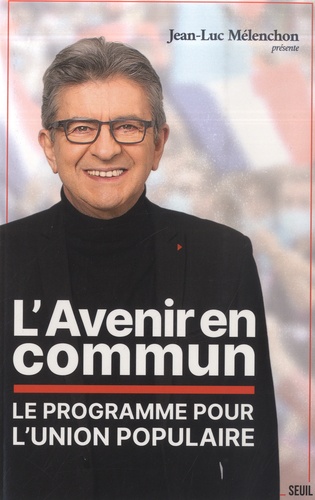

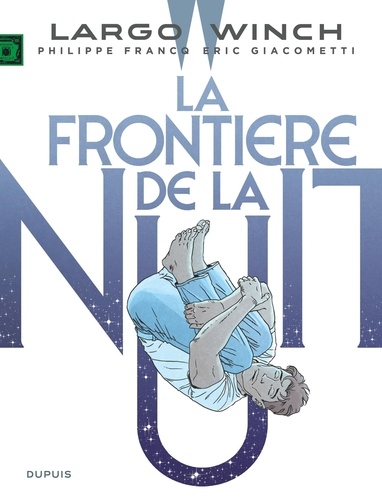

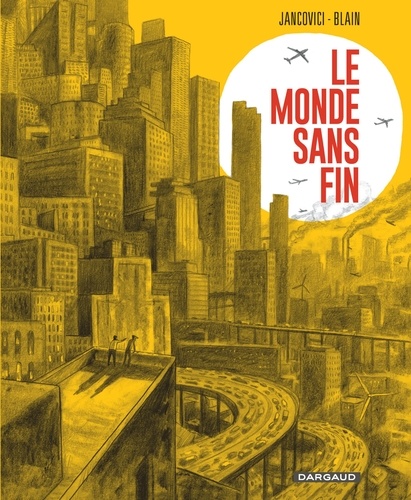
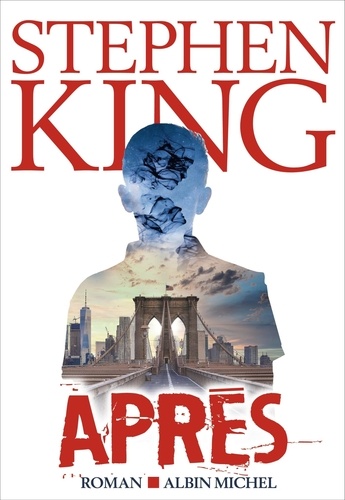

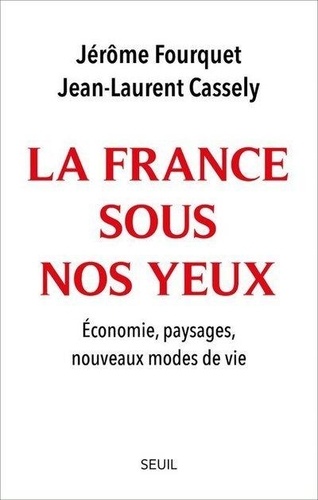
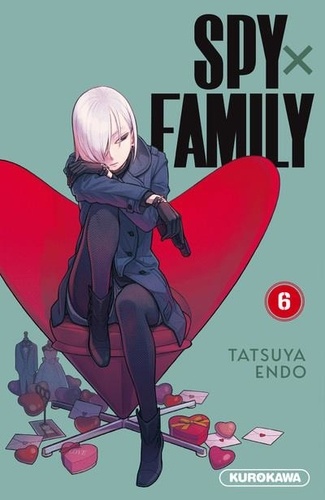
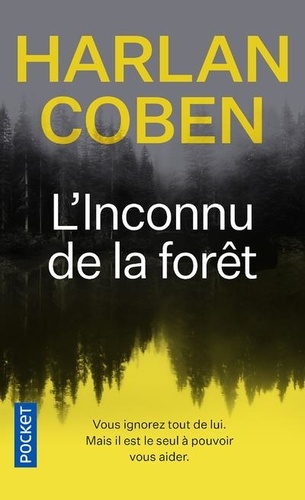


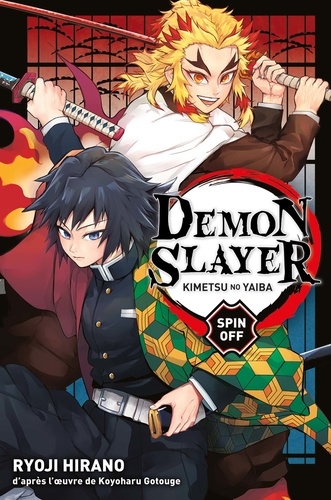
Commenter ce livre