Le divan de Staline
Jean-Daniel Baltassat
C'est l'automne sur la mer Noire. Mi-novembre, une fin d'après-midi de 1950, soleil bas et tendre. Iossif Vissarionovitch Staline, Guide et Petit Père du Monde Nouveau, élimine les fleurs fanées de vieux rosiers dans le jardin de la datcha du Frais Ruisseau. L'exercice le fatigue plus qu'avant. Le jardin n'est qu'une pente parcourue d'escaliers mais la vue sur la mer scintillante est une merveille. Sa datcha préférée. Il n'a plus que trente mois à vivre. Comment le saurait-il ?
Au moins les rosiers sont-ils en bon état. Peu de taches de rouille, presque pas d'oïdium. L'hiver s'annonce sec, autant que l'été. Ce qui ne convient pas si bien aux citronniers, à nouveau attaqués par les cochenilles. La nature est ainsi faite que tout finit par se corrompre et se livrer aux maladies, même ce qui a été purgé et récuré en profondeur. Un esprit négatif pourrait dire que le monde n'est qu'une plaie en perpétuelle rémission. Le genre de pensée qui vient avec l'âge et gâche le plaisir de beaux instants comme celui d'un jardin suspendu sur une mer embrasée par le couchant.
Pour ce qui est de la mort, Iossif Vissarionovitch se trouve somme toute dans la même situation que les millions d'âmes dont il a purgé la pureté soviétique. Il ignore quand elle va le rattraper, mais pas d'illusion. Même lui, le Généralissime de la moitié de la planète, le Khozjaïn, le Vojd, le Patron, ne peut pas se raconter d'histoires. Le jeu de la mort n'a qu'une issue. Plus le temps passe, plus on joue perdant. Depuis soixante-dix ans, les occasions de la rencontre finale n'ont pas manqué. Il s'en est bien tiré. Un rude boulot. Le hasard n'y est pour rien.
La longue expérience enseigne cependant une chose : la mort est le souci des faibles. Il y a plus fort que la mort : l'éternité. Une affaire qui ne se réduit pas à la survie d'un sac d'os et de chair. L'éternité : rester vivant dans l'esprit de nos survivants ainsi que ces astres éteints depuis des milliards d'années qui continuent d'éblouir nos nuits et nos ciels.
Une œuvre qui se prépare de loin. Lénine s'y est attelé tôt. On a été aux premières loges pour le voir à l'ouvrage. Une expérience édifiante. Voir et soutenir. Sans l'aide du camarade Staline, que serait devenue la sainteté d'Ilitch ?
Donc Iossif Vissarionovitch ôte ses gants, repose le sécateur dans ce petit panier qui accompagne toujours son ouvrage de jardinier. Le soleil du soir est tout près de se baigner dans la mer Noire. Une bienfaisance pour les os d'un vieil homme. Vieux dans le sac d'os, mais encore joueur comme à vingt ans pour ce qui est du reste et du goût de l'éternité.
Occupant tout le côté gauche de la datcha, la véranda est aussi vaste qu'une serre. Une tiédeur moite y perdure longtemps après le crépuscule. Des bassins de briques peintes emplis de crotons, azalées, rhododendrons, camélias et une splendeur de gardénia — dehors, le soleil et la terre calcaire vous les tueraient en moins de deux — encadrent deux fauteuils d'osier. Sur une table basse, des revues étrangères, des livres, une coupe de pipes Dunhill toutes semblables, des dossiers bariolés de toutes sortes de tampons colorés. De biais sur le fatras, un téléphone de bakélite verte. Son fil sinueux fait songer à un orvet se dorant dans la dernière chaleur du jour.
Iossif Vissarionovitch se laisse choir dans son fauteuil. Même battus et regonflés par les mains des femmes, les coussins conservent toujours son empreinte. Il se choisit une pipe parmi ses sœurs identiques, déplie sa blague à tabac — un cadeau de Churchill — une fille ronde, sans âge, en tablier blanc, apporte le thé. Du noir de Géorgie. Iossif Vissarionovitch suit les gestes de la fille, tasse le tabac dans sa pipe. Quand la fille ronde se redresse, d'une voix basse, aimable, il ordonne :
« Demande à Poskrebychev de venir. »
Elle quitte la véranda. Le tabac grésille sous l'allumette. Après deux ou trois bouffées, lossif Vissarionovitch décroche le combiné du téléphone vert. Trouvez-moi la camarade Vodieva, dit-il. Dites-lui que le camarade Staline attend son appel.
Le thé est juste à la bonne température. Il apaise ces gencives qu'on a trop souvent douloureuses.
Poskrebychev — major général Alexandre Nikolaïevitch Poskrebychev, directeur de la Section spéciale du Comité central, une tête chauve, très russe, solidement bolchevique, le nez court, les lèvres gourmandes aussi bien que sévères, la peau souvent livide tournant à la brique dans le grand froid ou les vapeurs de vodka, des yeux qui jamais ne fuient le regard de son Khozjaïn, son Vojd, son maître bien-aimé — dépose un classeur de courrier et son carnet de notes sur le fatras de la table ronde de la véranda. Poskrebychev est de ceux qui ne vont jamais les mains vides. Dans les couloirs du Kremlin, on le surnomme la Main et le Désir de Dieu. Pas de lettres, de requêtes, de rapports, de rendez-vous pour lossif Vissarionovitch qui ne reçoivent d'abord son attention et son approbation.
lossif Vissarionovitch soulève la couverture cartonnée du classeur. Il demande s'il y a une urgence. Les mots chuintent le long du tuyau de sa pipe déjà éteinte. Pas plus que d'habitude, répond Poskrebychev.
lossif Vissarionovitch se désintéresse du classeur, offre le dernier ocre du soleil à ses iris dorés. D'un ton égal, il annonce que la proposition du Politburo — la clique des scorpions, les Malenkov et Beria; Khrouchtchev avait l'air de s'en foutre — d'un monument d'éternité pour le camarade Staline, on va voir de plus près ce que ça vaut.
Bien sûr, Poskrebychev doit faire un effort pour se souvenir de quoi il s'agit. Une affaire qui remonte au printemps. Mais oui, oui maintenant il s'en souvient. Et aussi que le Patron l'avait éliminée d'un revers de main. Encore du léchage de cul de la clique.
L'inclinaison soucieuse, suspicieuse, du crâne nu de Poskrebychev amuse le Patron. Ses yeux jaunes s'allument d'un petit sourire. Ils disent: Tu as raison. Mais pourquoi ne pas voir ça de plus près ? Savoir à quoi ils jouent ? Savoir si c'est vraiment une mauvaise idée ?
C'est souvent que ces deux-là s'abstiennent de mots pour converser. Cela leur va tout aussi bien que les phrases ordinaires où ils s'obstinent à se vouvoyer.
« Bien, dit Poskrebychev. Bien. »
Et donc, après avoir rallumé sa pipe à la flamme d'une allumette plus lumineuse que ce soleil sombrant tout là-bas à l'ouest, Iossif Vissarionovitch précise ses désirs, les dates, lieux et noms nécessaires à mettre en branle la machine. Poskrebychev les griffonne sur son carnet. Une sténo toute personnelle que lui seul sait lire. Cela ne prend pas si longtemps. Il est déjà debout lorsque le téléphone sonne. « Lidia ! Lidia Semionova ! Ma Lidiouchka ! » s'exclame le Patron.
Poskrebychev quitte la véranda avec le sourire. La voix qui vibre dans son dos n'est plus du tout celle d'un homme de soixante-dix ans. Et de loin ! Plutôt celle d'un jeune homme. Que saint Lénine bénisse cette foutue Vodieva ! En voilà une qui saurait mieux qu'aucun monument rendre éternel le Petit Père des Peuples. Lidia ! Lidia ! Ma Lidiouchka !
Depuis longtemps Poskrebychev s'est accoutumé aux volte-face de lossif Vissarionovitch. Faire en sorte que les contingences quotidiennes, les devoirs et pouvoirs du camarade Staline n'en subissent aucun contretemps. Routine de la toute-puissance et nécessaire doigté. Ce qui n'est pas rien.
Par exemple, en ce milieu du mois de novembre 1950, on est à deux doigts d'une troisième guerre mondiale. Depuis juillet, les Américains avalent la Corée. Un mois plus tôt, Chou En-lai s'était assis dans la véranda en face de lossif Vissarionovitch, quémandant — à la manière chinoise, souriante, hypocrite et faussement soumise — soutien et aide pour la grande contre-offensive de Mao Tsé-toung contre les fascistes américains. Camarade Staline, nous avons besoin d'une couverture aérienne ! Les impérialistes US ont des avions par centaines et nous pas même une paire d'ailes valide ! Ce n'est pas seulement une affaire militaire, Généralissime. Le ciel de Corée sans avions soviétiques, ce serait comme revenir aux combats de la Longue Marche.
Staline a dit non.
Chou ne demandait pas beaucoup. Une poignée de MiG-15, ou des Yak-23. Une dizaine d'Iliouchine obsolètes aurait même pu faire l'affaire. N'importe quels engins capables d'agacer les dégénérés de Washington et de l'ONU. Staline a redit non. Trop tôt. Pas encore le rôle de l'Union soviétique. Plus tard, peut-être, on ne sait jamais. Chou a insisté. Staline est resté de marbre. « Qu'est-ce que vous croyez, camarade Chou ? L'URSS est désormais une puissance nucléaire. Elle ne s'engage pas comme ça dans une guerre contre les Américains. Chacun sa place. Notre responsabilité n'est pas la vôtre. »
Chou a quitté la datcha les lèvres en lame de cimeterre. Depuis, les divisions chinoises déferlent sur la Corée. Trois, quatre, cinq cent mille hommes, l'Armée des Volontaires du Peuple Chinois. À deux doigts d'encercler le 8e régiment de cavalerie US à Ulsan et harcelant déjà le IIe corps d'armée sud-coréen à Onjong. Comme ça. Sans le plus petit besoin d'une aile d'avion soviétique. Entre les lignes de leurs télégrammes codés, on peut entendre ricaner Mao et Chou.
Sans compter qu'il n'y a pas que la Corée et les mensonges impérialistes de l'ONU. Rien jamais ne permet de baisser la garde. Le Monde Nouveau Soviétique est pour ainsi dire une forêt nécessitant un élagage perpétuel. Aujourd'hui ici, demain là. Aujourd'hui taillons dans la vieille avant-garde pourrissante, demain nous trancherons dans l'hydre sioniste. Ici purgeons une clique de racailles d'anti-Parti — arrestations, enquêtes, aveux, tribunal, suaires — là curons sans relâche la vérole des traîtres, des saboteurs, des apostats. Et encore faut-il deviner les fruits blets dans les paniers toujours instables des Partis frères — accueillir aussi leurs fruits fatigués, comme en ce mois-ci le camarade Thorez, le Français au cœur fragile — et toujours et partout gardons-nous des Beria, Malenkov, Mikoïan et Khrouchtchev que l'oxygène du pouvoir saoule bien plus que la vodka. On l'a dit, la nature est ainsi faite que tout finit par se corrompre et se livrer aux maladies, même ce qui a été purgé et récuré en profondeur. Une tâche subtile. Par bonheur, Poskrebychev sait lui donner la calme apparence de l'ordinaire des jours.
Donc, de retour dans l'aile administrative, dite le Petit Kremlin, ajoutée à l'arrière de la datcha, il choisit un téléphone parmi les quatre — chacun d'une couleur différente, chacun voué à des conversations et des effets différents — qui peuplent son bureau. Dans le combiné noir, il dit : « Nikolaï, le Patron nous emmène prendre les eaux à Borjomi. » Sans attendre de réponse. Inutile. Nikolaï Vlassik — lieutenant-général Vlassik, chef de la Section opérationnelle de la Sécurité d'État, cent trente kilos pour un mètre soixante-neuf, responsable de la protection personnelle du Généralissime Staline — bolchevik de la même trempe que Poskrebychev, quoique en plus lourd, plus adipeux et moins intelligent, est capable encore de se lever chaque aube pour que demeure intact le corps sacré de l'État Soviétique.
Ensuite, dans le combiné vert — ligne directe pour le Kremlin, sûre, hautement sécurisée, propice à la diffusion des ordres et des contrôles — plus tard dans le blanc, tout se met en place jusque là-bas tout au fond de la Géorgie natale de Iossif Vissarionovitch, dans ce Palais Likani où il veut aller se divertir pour une poignée de jours. Et alors qu'il ordonne, vérifie, fait répéter, Poskrebychev, avec cette tendresse qui n'appartient qu'à l'amour des hommes pour les plus puissants qu'eux, ne cesse d'entendre le cri bienheureux de son saint Patron — Lidia ! Lidia ! Ma Lidiouchka ! — ainsi qu'autrefois les Vojd de la vieille Russie faisaient claquer le fouet sur la croupe des mules lancées dans la steppe glacée. Lidia ! Lidia ! Ma Lidiouchka !
Extraits

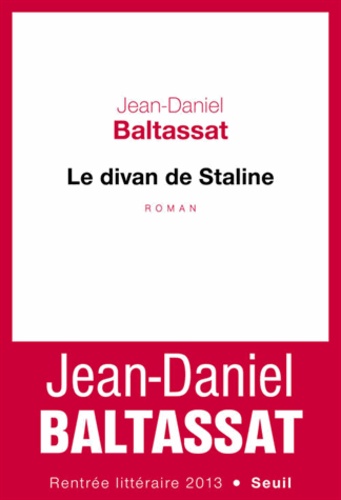


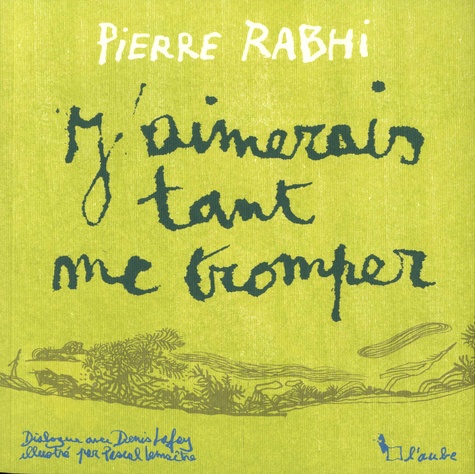
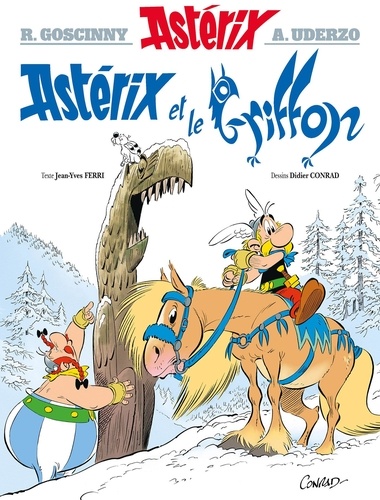
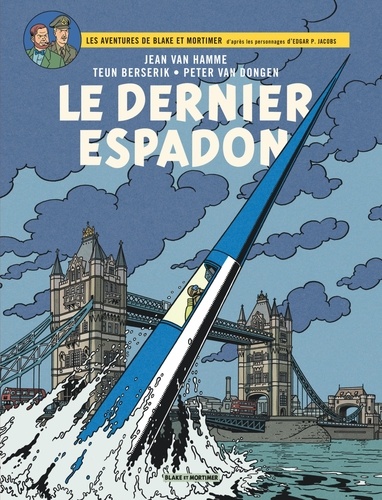
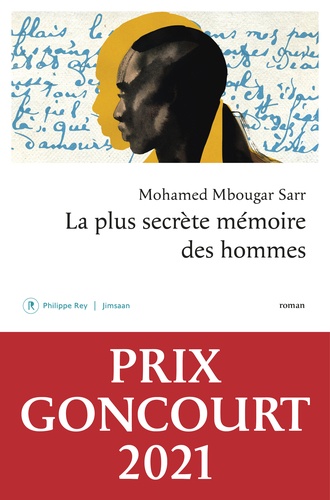
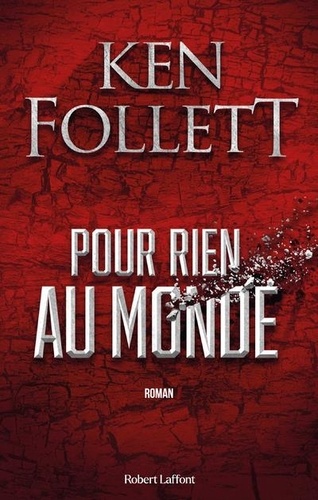
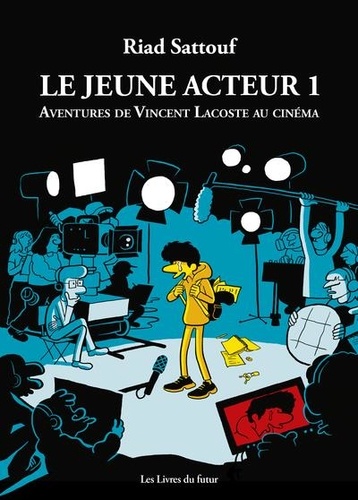
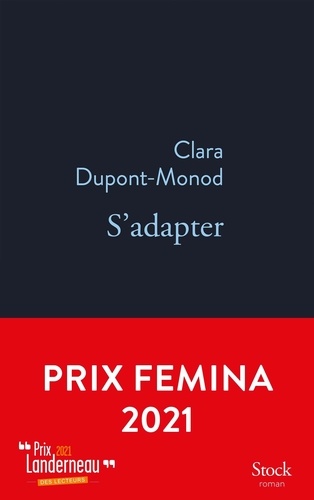
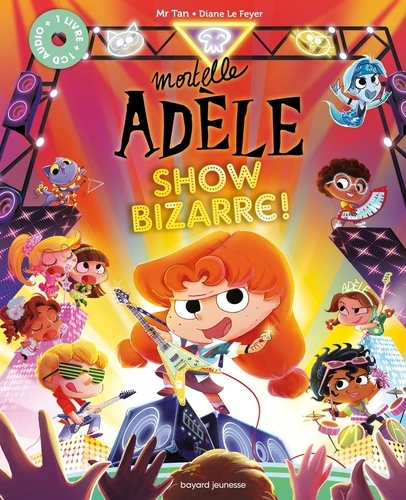
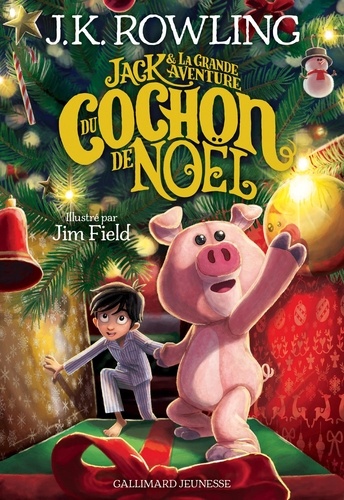
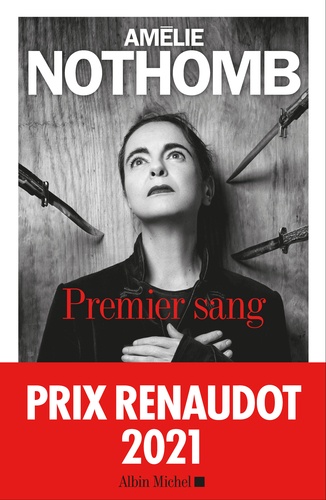

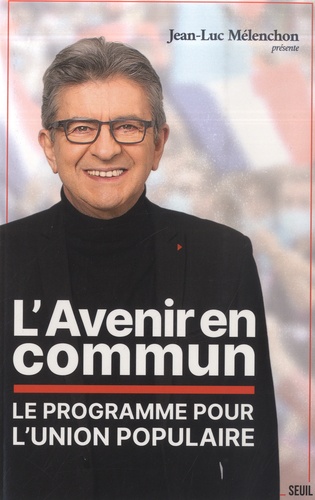

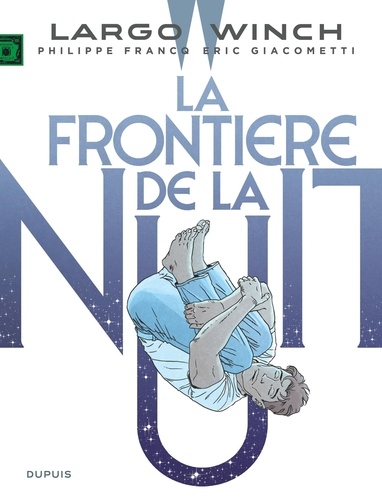

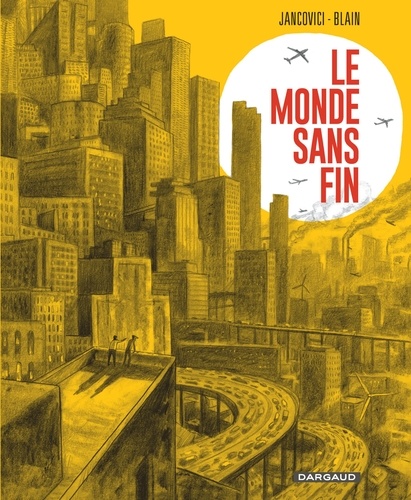
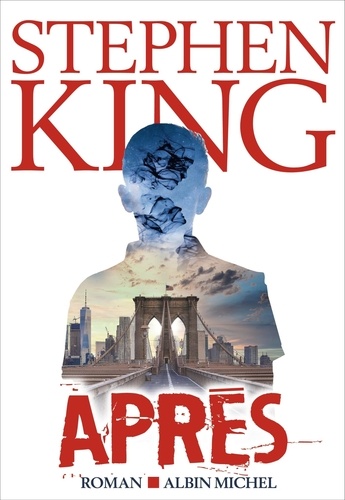

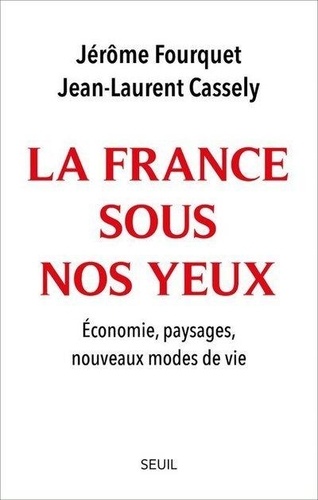
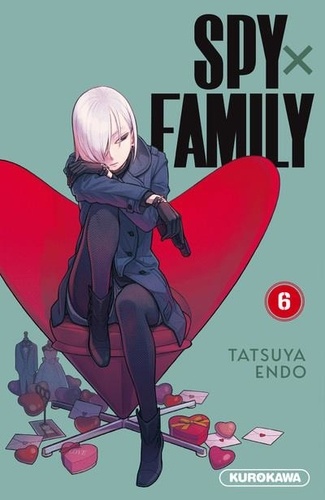
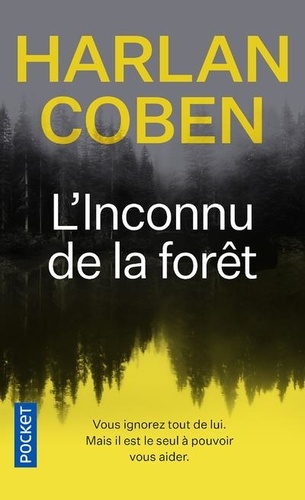


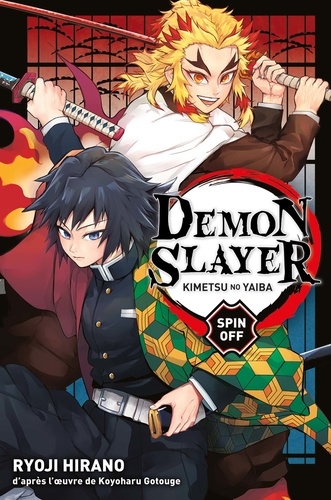
Commenter ce livre