Le corps du héros
William Giraldi
Editeur
Genre
Littérature étrangère
Le Corps du héros est un roman non fictionnel, mais beaucoup de noms ont été changés et les caractéristiques identifiables de certaines personnes modifiées. La salle de sport où certains passages se déroulent n’a aucun lien avec des structures existantes qui possèdent la même dénomination.
À la mémoire de mon père,
William Giraldi (1952-2000),
et à mes fils, Ethan, Aiden et Caleb,
afin qu’ils apprennent à le connaître.
Prologue
Les premiers signes de la maladie ont été une semaine de léthargie générale, comme quand la grippe se manifeste peu à peu. Bientôt, il y a eu des migraines – pas le front douloureux comme lorsqu’on est déshydraté ni la pulsation derrière les yeux après avoir lu dans une lumière tamisée, mais un mal lancinant dans tout l’avant du corps qui, au bout de quelques jours, a migré vers la nuque. Puis les vagues sont arrivées, des jours entiers d’étourdissement, suivis par une raideur, une incapacité progressive à tourner la tête à droite ou à gauche. L’infection avait envahi tout mon corps, quelque chose de toxique qui circulait dans le sang. Douze jours plus tard, j’ai perdu connaissance dans un couloir du lycée et je me suis effondré contre le vestiaire de quelqu’un. Cet automne-là, j’avais quinze ans, j’étais en seconde. Des amis m’ont transporté jusqu’à l’infirmerie où je me suis réveillé, je n’avais qu’une vision partielle du monde teinté de gris.
Puis j’étais sur un lit chez mes grands-parents, dans la pénombre d’une chambre, et je ne savais pas depuis combien de temps j’étais là ni combien de temps il avait fallu pour que j’y arrive, et je n’allais plus assez bien pour avoir peur. Une minute ou une heure plus tard, mon père m’a conduit à toute vitesse à travers la ville chez un médecin généraliste qui venait d’ouvrir son cabinet. Nous n’avions plus de médecin de famille attitré depuis des années : quand ma mère était partie – j’avais alors dix ans –, mon père, qui était charpentier, n’avait pas d’assurance maladie. Il m’a porté jusqu’à l’intérieur du cabinet, un petit fardeau sans os posé sur ses épaules ; le docteur a tout de suite compris ce qui était en train de me tuer.
Le mot « méningite » avait quelque chose de radical. Le médecin a ordonné à mon père de me conduire immédiatement à l’hôpital, et c’est cet adverbe en italique qui me l’a fait comprendre : je risquais le pire. Lui-même s’y précipiterait pour effectuer la ponction lombaire. Un jour, j’avais vu un film d’horreur dans lequel un des personnages avait une méningite, une jeune femme malade dont la colonne vertébrale transperçait la peau – elle avait l’air fossilisé. Je mourrais donc bientôt en me décomposantvivant, une fin lente et horrible, souffrant le martyre jusqu’au bout. Couché sur le dos et haletant sur la banquette arrière tandis qu’on roulait vers l’hôpital, j’ai demandé à mon père : « C’est quoi, une ponction lombaire ? – Je crois qu’ils tapent sur ta colonne vertébrale avec un petit marteau en caoutchouc », m’a-t-il répondu, et je n’ai pas compris qu’il essayait d’être drôle. Bientôt, j’étais de nouveau inconscient, même si je comprenais plus ou moins que j’étais suspendu dans une capsule de peur et de douleur.
Extraits

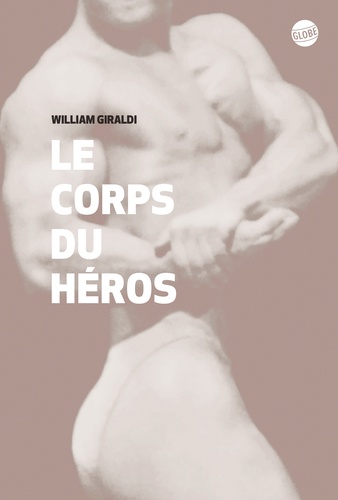


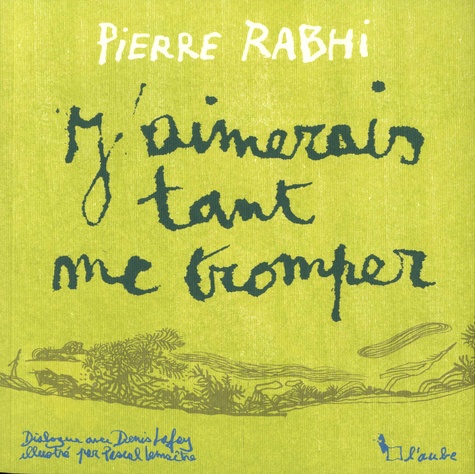
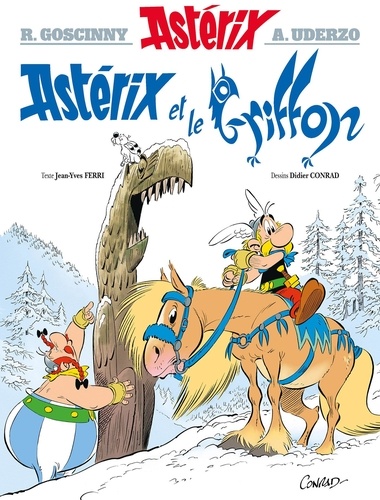
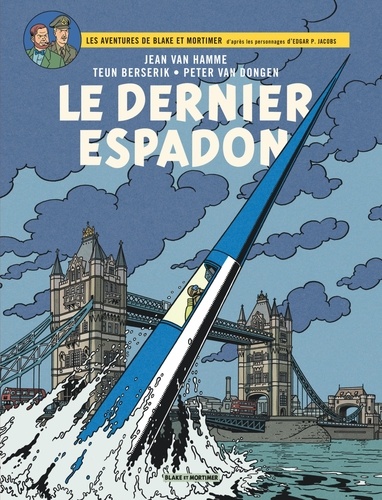
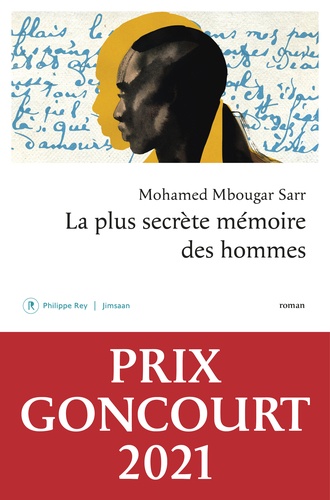
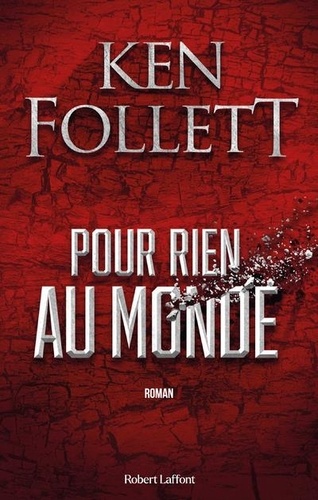
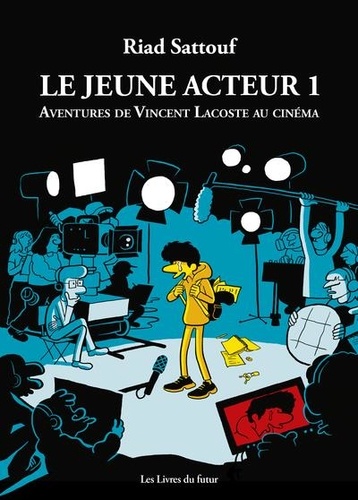
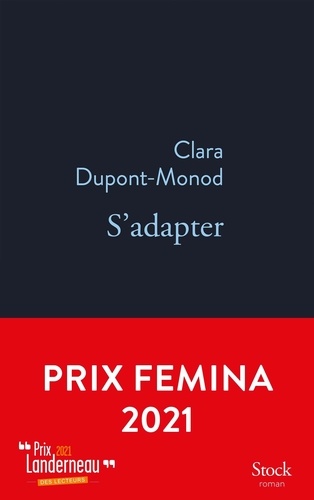
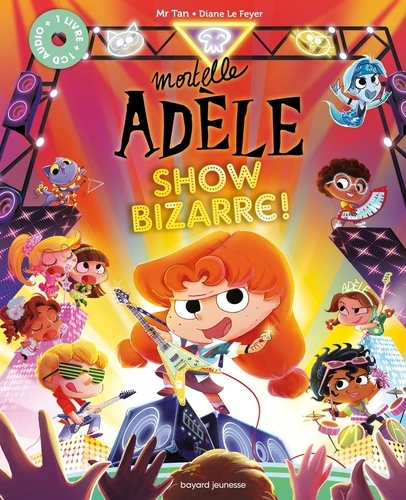
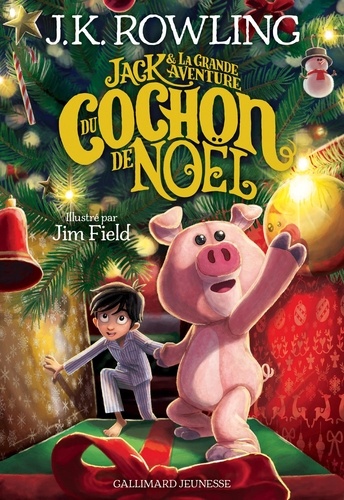
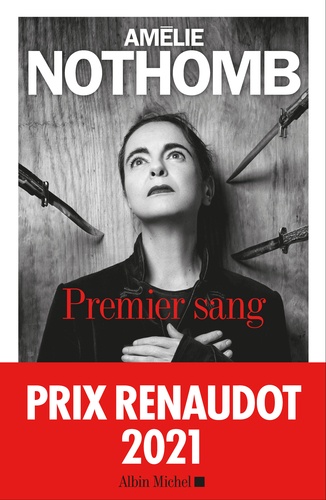

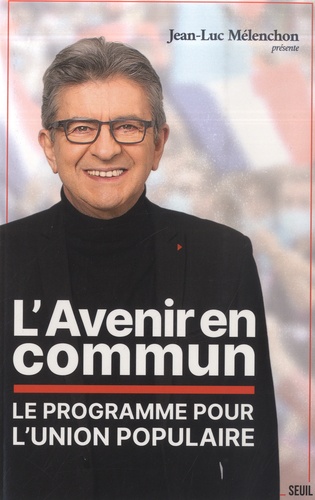

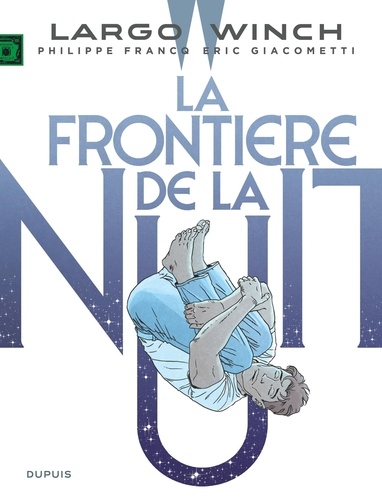

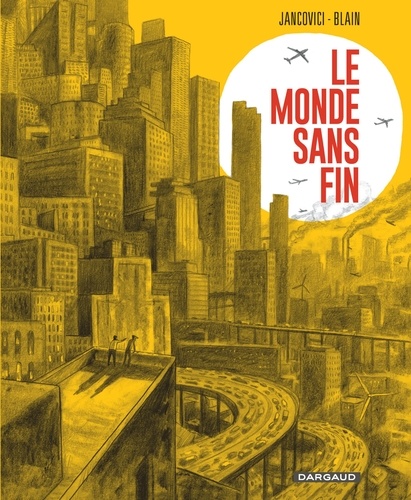
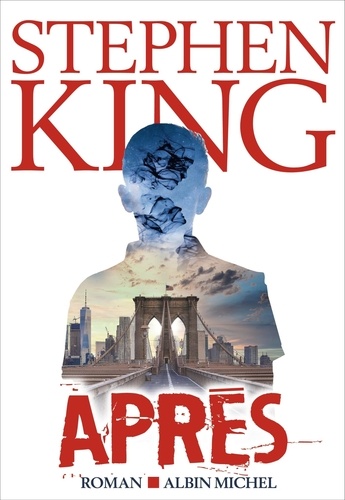

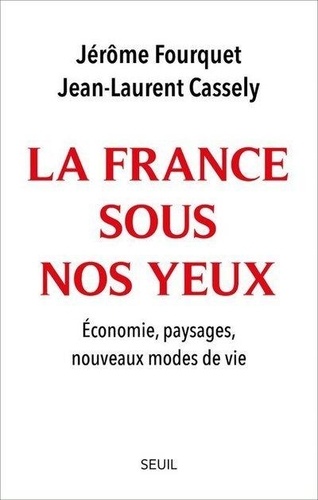
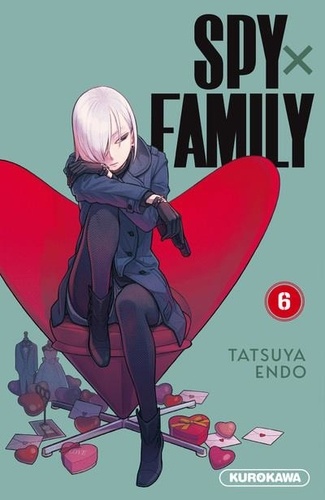
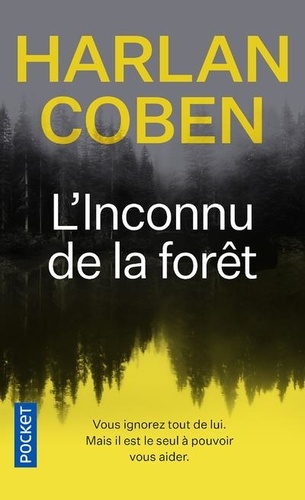


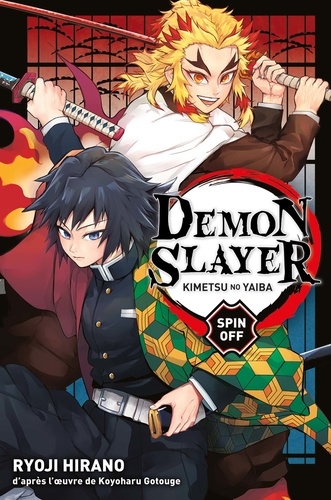


Commenter ce livre