Allons-nous liquider la science ? Galilée et les Indiens
Etienne Klein
PRÉFACE À L’ÉDITION DE POCHE
Notre rapport à la science est à l’évidence devenu ambivalent. Cela peut se voir sous forme condensée en mettant l’une en face de l’autre les deux réalités suivantes : d’une part, la science nous semble constituer, en tant qu’idéalité (c’est-à-dire en tant que démarche de connaissance d’un type très particulier qui permet d’accéder à des connaissances qu’aucune autre démarche ne peut produire), le fondement officiel de notre société, censé remplacer l’ancien socle religieux : nous ne sommes certes pas gouvernés par la science elle-même, mais au nom de quelque chose qui a à voir avec elle. C’est ainsi que dans toutes les sphères de notre vie nous nous trouvons désormais soumis à une multitude d’évaluations, lesquelles ne sont pas prononcées par des prédicateurs religieux ou des idéologues illuminés : elles se présentent désormais comme de simples jugements d’« experts », c’est-à-dire sont censées être effectuées au nom de savoirs et de compétences de type scientifique, et donc, à ce titre, impartiaux et objectifs. Par exemple, sur nos paquets de cigarettes, il n’est pas écrit que fumer déplaît à Dieu ou compromet le salut de notre âme, mais que « fumer tue ». Un discours scientifique, portant sur la santé du corps, a pris la place d’un discours théologique qui, en l’occurrence, aurait plutôt porté sur le salut de l’âme.
Mais, d’autre part – et c’est ce qui fait toute l’ambiguïté de l’affaire –, la science, dans sa réalité pratique, est questionnée comme jamais, contestée, remise en cause, voire marginalisée. Elle est à la fois objet de désaffection de la part des étudiants (les jeunes, dans presque tous les pays développés, se destinent de moins en moins aux études scientifiques), de méconnaissance effective dans la société (nous devons bien reconnaître que, collectivement, nous ne savons pas trop bien ce qu’est la radioactivité, en quoi consiste un OGM, ce que sont et où se trouvent les quarks, ce qu’implique la théorie de la relativité et ce que dirait l’équation E = mc2 si elle pouvait parler) et, enfin et surtout, elle subit toutes sortes d’attaques, d’ordre philosophique ou d’ordre politique.
Cette ambivalence est accentuée par le fait suivant : notre société doute de plus en plus de l’idée même de vérité. Plus précisément, elle semble parcourue par deux courants de pensée qui semblent contradictoires. Tout d’abord, on y trouve un attachement intense à la véracité, un souci de ne pas se laisser tromper, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière, bref une attitude de défiance généralisée. Mais à côté de ce désir de véracité, de ce refus d’être dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l’égard de la vérité elle-même : la vérité existe-t-elle ? se demande-t-on. Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, culturelle ? Ce qui est troublant, c’est que ces deux attitudes, l’attachement à la véracité et la suspicion à l’égard de la vérité, qui devraient s’exclure mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées puisque le désir de véracité suffit à enclencher au sein de la société un processus critique qui vient ensuite fragiliser l’assurance qu’il y aurait des vérités sûres. Le fait que l’exigence de véracité et le déni de vérité aillent de pair ne veut toutefois pas dire que ces deux attitudes fassent bon ménage. Car, si vous ne croyez pas à l’existence de la vérité, quelle cause votre désir de véracité servira-t-il ? Ou – pour le dire autrement – en recherchant la véracité, à quelle vérité êtes-vous censé être fidèle ? Il ne s’agit pas là d’une difficulté seulement abstraite ni simplement d’un paradoxe : cette situation entraîne des conséquences concrètes dans la cité réelle et vient nous avertir qu’il y a un risque que certaines de nos activités intellectuelles en viennent à se désagréger.
Extraits




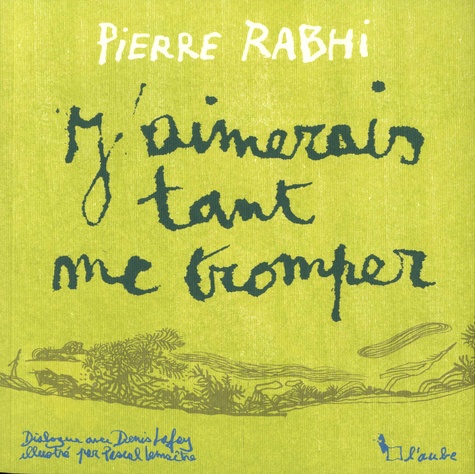
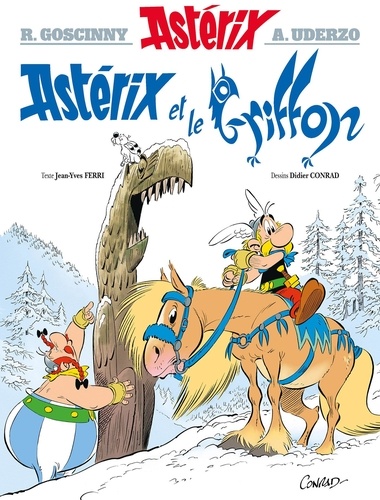
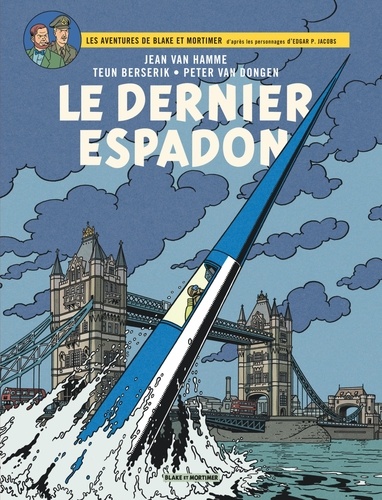
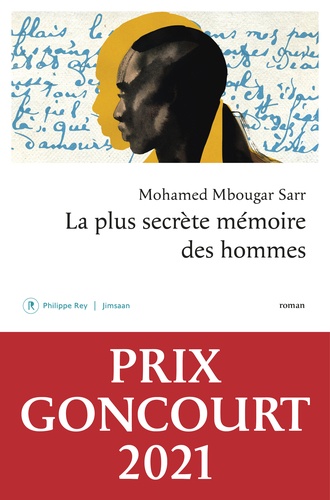
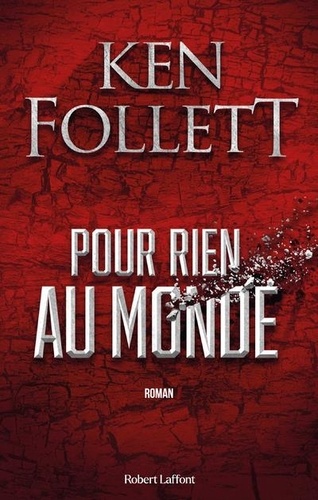
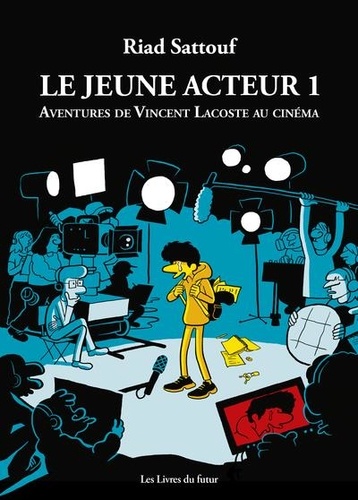
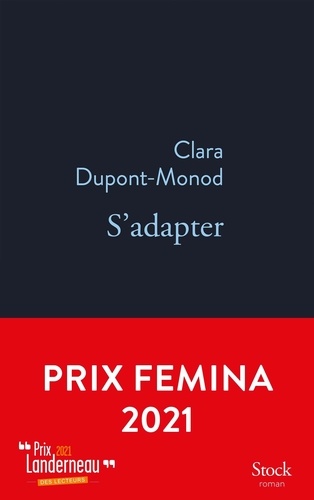
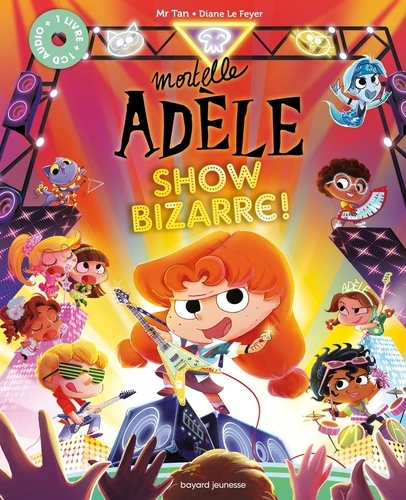
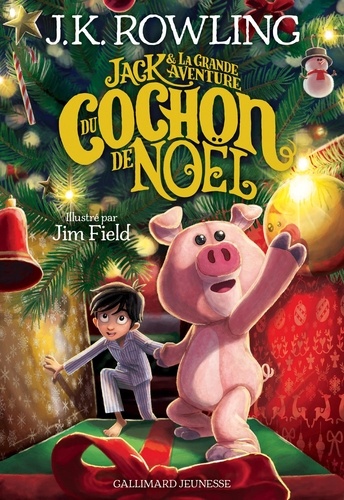
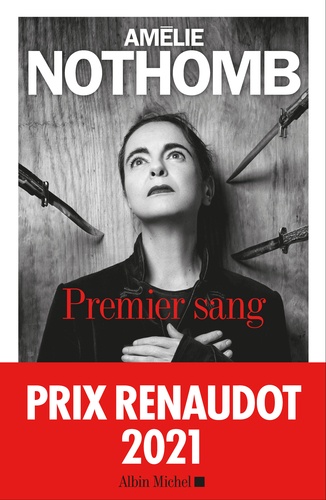
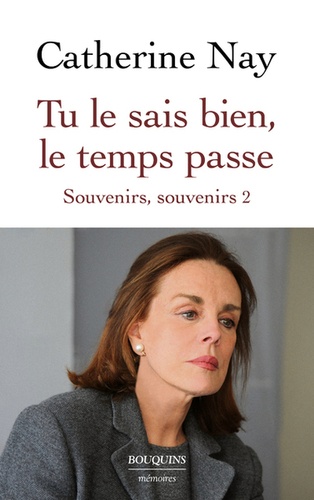
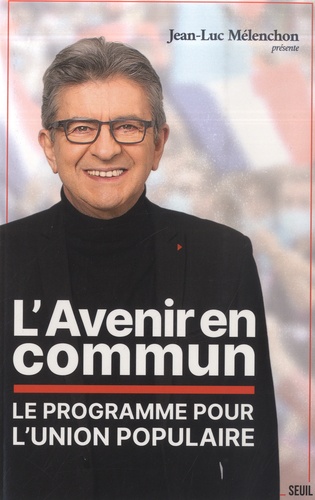

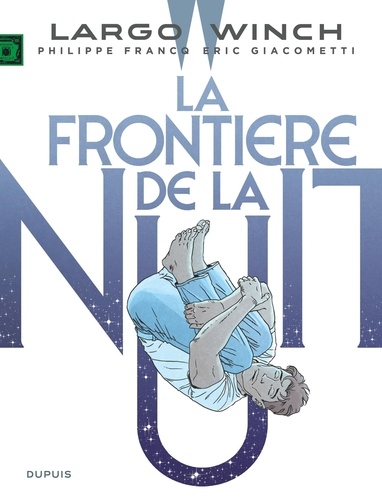
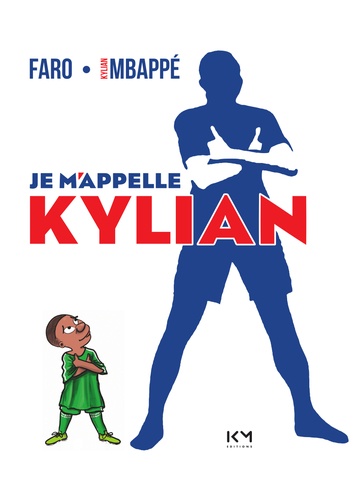
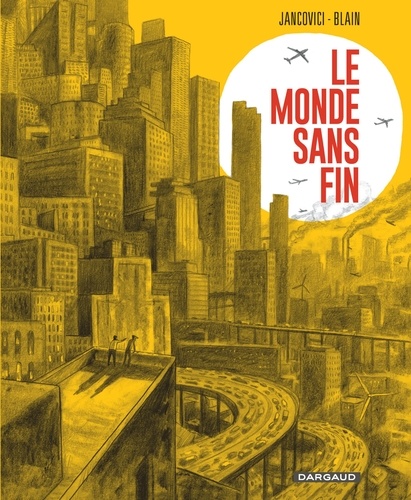
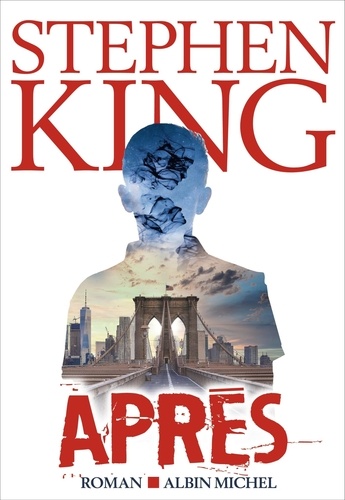
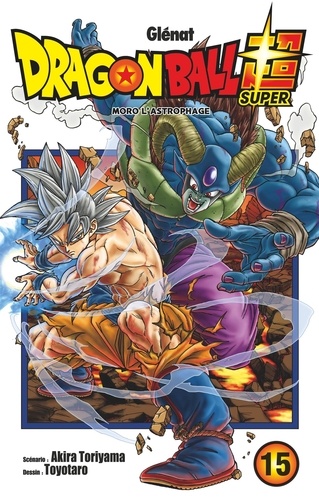
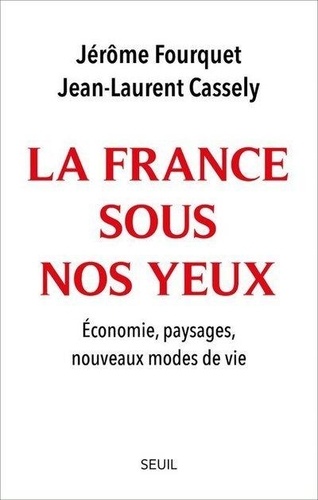
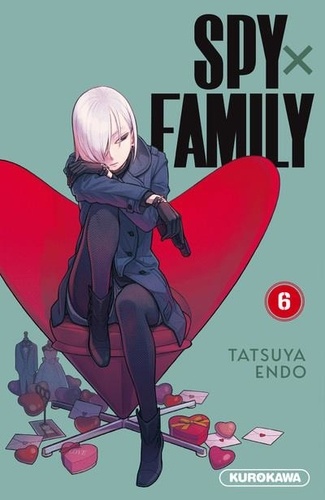
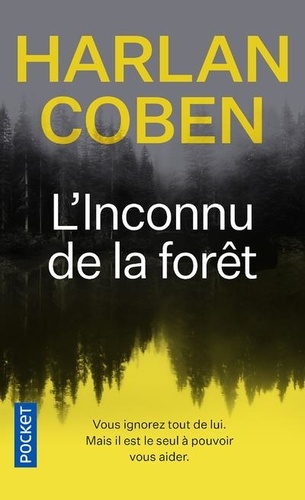
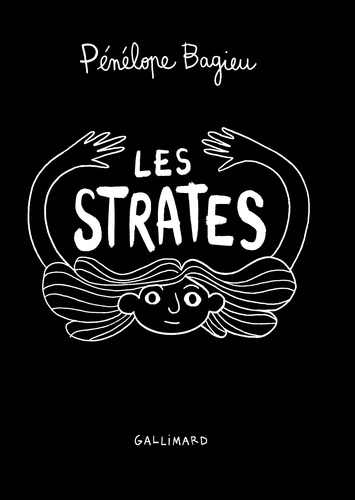
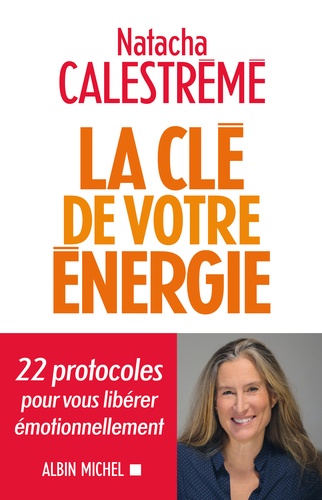
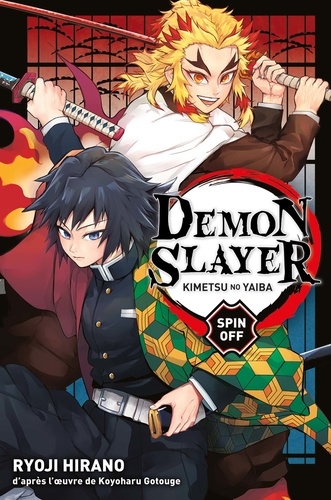

Commenter ce livre